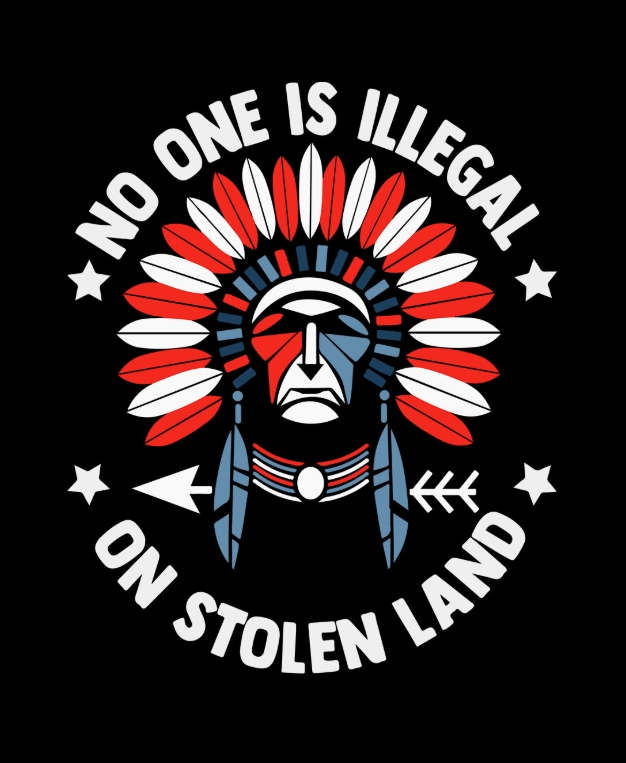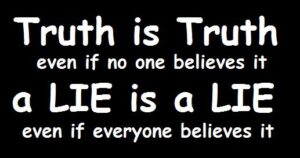Le nouveau projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier suscite la controverse au Québec. Les leaders autochtones, inquiets que la loi proposée pourrait porter atteinte à leurs droits inhérents et issus de traités, mènent l’opposition aux changements. Mais ils ne sont pas seuls. Les groupes environnementaux, les syndicats et les chercheurs en foresterie expriment tous leur opposition à la loi. Le projet de loi 97, intitulé « Loi visant principalement à moderniser le régime forestier », a été déposé le 23 avril. Avec cette proposition, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre des changements ambitieux. Le projet de loi prévoit une refonte importante de la gestion forestière au Québec, avec des changements radicaux aux lois existantes et un nouveau système à trois zones (« triade »). Le système de triade vise à révolutionner la gestion forestière en divisant les forêts en zones de développement forestier prioritaires (pour l’exploitation forestière intensive), en zones de conservation et en zones polyvalentes qui équilibrent la conservation et le développement. Le gouvernement CAQ vise à ce que les zones de développement représentent au moins 30 % des forêts du Québec. Selon un article publié le 10 juin sur son blogue, l’ingénieur forestier et chercheur Eric Alvarez affirme que 23,56 millions d’hectares de forêt sont identifiés comme potentiellement exploitables. « Cela réserverait quelque 8 millions d’hectares à la seule industrie forestière. Huit millions d’hectares où tous les autres intervenants et utilisateurs de la forêt publique n’auront qu’une chose à faire : se taire. » Pourquoi cette loi, et pourquoi maintenant ? Au fond, le projet de loi 97 est une tentative de résoudre un débat sur la foresterie qui perdure depuis plus d’un quart de siècle au Québec. Dans les années 1980 et 1990, la province s’est livrée à des activités de coupe à blanc que la Commission Coulombe (2003-2004) a finalement jugées excessives et destructrices. Au cours des 20 dernières années, les gouvernements successifs du Parti libéral et du Parti québécois ont adopté des lois visant à harmoniser la foresterie avec les besoins de l’écosystème et à confier au gouvernement québécois la gestion des forêts, la mise aux enchères du bois et la fixation des prix. Le projet de loi 97 propose une série de changements. En commençant par remplacer le principe régnant de la gestion des écosystèmes par le système de triade de désignation des zones, les nouvelles règles empêchent également ce que le projet de loi appelle « certaines activités ayant pour effet de restreindre la réalisation des activités d’aménagement forestier ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation du territoire. » Bien que controversé pour certains, le projet de loi 97 a reçu le soutien de l’industrie. En mai, peu après le dépôt du projet de loi, une lettre ouverte en sa faveur a été publiée dans le Journal de Montréal, signée par les présidents et PDG du Conseil de l’industrie forestière du Québec, de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, du Conseil des employeurs du Québec, de Manufacturiers et Exportateurs du Québec et de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Réaction des Autochtones Dans un communiqué de presse publié deux jours après la présentation du projet de loi, le chef régional, Francis Verreault-Paul, de l’Association des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), a fait valoir que le projet de loi ignorait les droits inhérents des communautés autochtones. « Le libellé du projet de loi présenté le 23 avril est extrêmement surprenant et décevant, » écrit Verreault-Paul, « d’autant plus que nous avons discuté avec la ministre depuis plus d’un an et formulé des recommandations claires qui n’ont pas été retenues. Des recommandations qui, en plus d’être formulées à partir de l’expertise de nos Premières Nations, sont fondées sur les droits inhérents sur nos territoires. » Les objections des Autochtones portent principalement sur le fait que le projet de loi ne reconnaît pas leurs droits inhérents. Cette question est étroitement liée à la proposition de privatiser un tiers des terres du Québec, dont près de la moitié n’ont pas été cédées et ne font pas l’objet de traités. De nombreux dirigeants ont affirmé que le projet de loi 97 ignore la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Devant la Commission de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale du Québec au début du mois de juin, chef Vérreault-Paul a été rejoint par plusieurs autres chefs, dont Lucien Wabanonik, chef de la nation Anishnabe du Lac-Simon. Wabanonik a exprimé son extrême mécontentement face à la possibilité que le projet de loi accorde à l’industrie forestière un accès prioritaire à 30 % des territoires ancestraux des Premières Nations, subordonnant ainsi les droits des Premières Nations à ceux de l’industrie forestière. Selon Wabanonik, ces propositions font du projet de loi 97 « une insulte à notre intelligence » et « une provocation directe à nos membres en territoire » qui « constitue un acte de dépossession de nos terres ». Il a déclaré que le projet de loi fait preuve d’une tolérance récalcitrante envers les peuples autochtones dans la mesure où il n’interdit pas les activités traditionnelles, mais seulement si elles ne nuisent pas à l’exploitation forestière. Wabonik soutient que l’exploitation forestière prime sur les droits des Autochtones aux yeux du gouvernement du Québec. « Nous voulons collaborer. Mais pas sur la base de votre projet de loi, » a-t-il souligné. « Nous rejetons votre projet de loi. On ne peut pas repartir sur une base déjà brisée. » En fait, les dirigeants des Premières Nations, dont Wabanonik, ont commencé à réagir au projet de loi 97 bien avant qu’il ne soit déposé, pendant la période de consultations qui a précédé sa rédaction. En décembre, Wabanonik et 19 autres chefs ont répondu à une présentation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts sur le processus de planification par une lettre ouverte exprimant leur rejet catégorique. « Nous rejetons catégoriquement votre proposition et réclamons une réforme transparente, équitable et en respect avec nos droits ancestraux » lit la lettre adressée à la ministre Maïté Blanchette-Vézina. « Faut-il vous rappeler les derniers jugements de la cour? Vous avez le devoir constitutionnel de nous consulter en bonne et due forme. Vous ne pouvez pas partitionner le territoire pour nous déposséder d’une partie de nos terres et les offrir à l’industrie. » Les défenseurs des terres Atikamekw érigent un tipi pour affirmer leur souveraineté sur leurs terres près de Wemotaci. Photo : Archives APTN Alliance et expulsion Le 11 avril, deux semaines avant le dépôt du projet de loi, des membres des nations innues et atikamekw, ainsi que des nations abénaquises du sud du fleuve Saint-Laurent, ont formé le groupe Mamo-Mamu First Nations. Mamo-Mamu, dont le nom signifie « ensemble » en atikamekw et en innu, se décrit comme une alliance de chefs héréditaires et de défenseurs des terres et ne représente pas les chefs et les conseils élus. Le groupe a réagi au dépôt du projet de loi 97 par une série de barrages routiers et de manifestations dans divers endroits des territoires innus et atikamekw, en particulier sur les chemins forestiers à l’extérieur de zones telles que la communauté innue de Mashteuiatsh (près du lac Saint-Jean) et la communauté atikamekw de Wemotaci, près du centre forestier de La Tuque. Certaines de ces manifestations se sont étendues jusqu’aux rues de Montréal, au sud. En mai, les Premières Nations Mamo-Mamu, en collaboration avec le groupe allié Association des Gardiens du territoire Nehirowisiw Aski, ont intensifié leurs tactiques en envoyant une lettre recommandée d’expulsion à 11 entreprises forestières. « Sur réception de cette lettre vous avez la responsabilité d’informer vos employés et contracteurs de quitter notre territoire sur le champ et jusqu’à nouvel ordre, » la lettre indiquait. « Cet ordre d’expulsion vise spécifiquement les abatteuses multifonctionnelles, nous ne voulons aucune nouvelle coupe forestière. […] Par la présente, nous vous informons que tous vos employés et contracteurs doivent évacuer immédiatement nos territoires traditionnels autochtones non cédés. » À l’heure actuelle, les membres des Premières Nations Mamo-Mamu poursuivent leurs barrages routiers et autres manifestations pour affirmer leur présence sur les routes forestières près de communautés telles que la Première Nation atikamekw de Manawan. Menace d’action en justice Quelque temps après la déclaration de l’APNQL et la création de la Première Nation Mamo-Mamu, le gouvernement de la Nation crie a fait sa propre déclaration publique au sujet du projet de loi. La nation crie d’Eeyou Istchee, qui comprend neuf communautés à l’est de la baie James, a négocié le premier traité moderne du Canada, la Convention de la baie James et du Nord québécois, en 1975 avec le gouvernement libéral du Québec de l’époque. Elle a ensuite négocié la Paix des Braves avec le gouvernement du Parti québécois en 2002. Parallèlement, à la fin des années 1980, la nation crie a également organisé une série de manifestations coordonnées et d’actions de pression contre le projet du gouvernement québécois de construire un barrage sur la rivière Great Whale (près de la communauté crie inuite de Whapmagoostui-Kuujjuarapik), qui a finalement abouti à l’annulation de ce projet de plusieurs milliards de dollars. Entre protestation et négociation, la nation crie a développé une position de pouvoir politique et économique unique parmi les Premières Nations du Québec. Là où d’autres Premières Nations pourraient recourir à des barrages routiers, le gouvernement de la nation crie a souvent fait appel à des cabinets d’avocats renommés pour obtenir des recours juridiques inaccessibles à de nombreuses communautés plus petites. Dans son communiqué de presse, le gouvernement de la nation crie a reconnu que le projet de loi 97 mentionne qu’il ne prévaut pas sur les dispositions de la Paix des Braves de 2002. « La Paix des Braves est un accord juridiquement contraignant », indique le communiqué, « et le régime forestier adapté prévu dans la Paix des Braves est incorporé par renvoi dans la CBJNQ, qui est protégée par la Constitution. À ce titre, il fait partie du cadre des traités de la Nation crie et reflète les obligations mutuelles de la Nation crie et du gouvernement du Québec. » La déclaration de la Nation crie se termine en affirmant que ses représentants « procèdent actuellement à un examen détaillé du projet de loi 97 et engageront des discussions directes avec le gouvernement du Québec afin de s’assurer que sa mise en œuvre respecte et soit en totale conformité avec nos obligations découlant des traités, nos engagements communs et nos structures de gouvernance reconnues ». Les défenseurs des terres opposés au projet de loi 97 attachent les poteaux d’un tipi. Photo : Archives APTN L’opposition non autochtone Alors que des groupes, tels que la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), Nature Québec, le Centre de droit de l’environnement du Québec, ainsi que la CSN et UNIFOR, les syndicats représentant les travailleurs forestiers du Québec, ont publiquement dénoncé le projet de loi 97, certaines des critiques les plus virulentes sont venues des experts forestiers eux-mêmes. L’un des rejets les plus frappants du projet de loi est venu du chercheur dont les travaux sur la foresterie triadique ont inspiré le projet de loi 97. Le professeur Christian Messier, expert forestier du département de biologie de l’Université du Québec à Montréal, travaille depuis des décennies sur l’approche de la triade. Blanchette Vézina a invoqué son nom et ses recherches pour élaborer le projet de loi 97. Pourtant, Messier a déclaré au journal La Presse que le projet de loi 97 « va être l’enfer. Il va y avoir un bris de confiance. Ça va créer de l’antagonisme. » Dans un commentaire publié séparément dans La Presse, Messier explique qu’il a dirigé une équipe chargée de tester l’approche du zonage en triade dans une région d’un million d’hectares au nord de La Tuque. Fort de cette expérience, il conclut que les trois niveaux d’utilisation devraient également servir de système de priorités, en protégeant d’abord la biodiversité, puis en minimisant les conflits d’utilisation, avant de maintenir la production de bois. Messier conclut : « La triade ne devrait donc pas être mise en place avec comme principal objectif d’aider l’industrie forestière, comme cela semble être présenté par la ministre. » Dans une lettre ouverte publiée dans La Presse et cosignée par 36 experts, quatre professeurs du Centre de recherche forestier du Québec décrivent le projet de loi 97 comme « [tenant] très peu compte des avancées scientifiques récentes dans le domaine forestier. ». Ils soulignent que le gouvernement ne les a pas consultés, alors qu’ils constituent une organisation clé dans le domaine forestier québécois, regroupant 12 universités québécoises et plus de 85 chercheurs, et publiant plus de 200 articles par an. Robert Beauregard, ancien doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, estime que certains aspects clés du projet de loi 97 présentent de fortes similitudes avec certains aspects de la Loi sur les forêts des années 80 qui ont été abandonnés en 2010. Dans son propre commentaire publié dans La Presse, Beauregard prédit que si le projet de loi 97 est adopté, le secteur forestier connaîtra une brève période de prospérité, suivie de « fermetures massives d’usines d’ici 10 à 15 ans ». Que va-t-il se passer ensuite ? Avant même la déclaration du gouvernement de la Nation crie, Blanchette-Vézina avait signalé sa volonté de céder du terrain sur le projet de loi 97. À la suite de consultations publiques, le ministre a publié un message le 6 juin sur X, anciennement Twitter. Le communiqué indique, en partie : « Des amendements importants seront apportées [sic], notamment en collaboration avec les Premières Nations. C’est essential pour moi de travailler avec les acteurs du milieu – et je vais continuer de le faire cet été. Je reviendrai avec un projet de loi bonifié, à la hauteur des défis auxquels fait face la forêt. Nous avons tous la responsabilité d’échanger dans le respect et les blocus doivent cesser. Chaque emploi perdu en région est un emploi de trop. Il est temps d’agir, par responsabilité envers les travailleurs et les communautés forestières [sic] qui, face à la pression tarifaire, ont besoin plus que jamais d’oxygène. » Cependant, le 9 juin, le premier ministre du Québec, François Legault, a semblé minimiser les propos du ministre en déclarant : « Il n’y a pas de grands changements qui, pour l’instant, sont prévus, mais des ajustements. » Il a ajouté : « Maïté Blanchette-Vézina a toujours dit qu’elle était pour consulter en commission, ce qu’elle a fait. Évidemment, quand on consulte, c’est pour améliorer le projet de loi, mais, essentiellement, le projet de loi va continuer d’être un nouveau régime qui donne plus de prévisibilité, qui assure des emplois dans toutes les régions du Québec. Mais effectivement, on a écouté les peuples autochtones, on a écouté les gens qui veulent protéger le caribou. Mais il faut que ça soit équilibré. » Alors que l’Assemblée nationale du Québec est en vacances estivales, les opposants au projet de loi 97 ne se sont pas disparus. Au contraire, ils s’organisent, et certains militent pour que le débat soit porté dans les centres urbains du Québec. Le 22 juin, les organisateurs ont organisé une manifestation contre le projet de loi 97 qui a débuté au Stade olympique de Montréal, rassemblant une centaine de manifestants dans les rues. La plus récente manifestation à Montréal a eu lieu mardi dernier, le 1er juillet. Continue Reading
Lopposition au projet de loi 97 sur la foresterie prend de lampleur

Leave a Comment