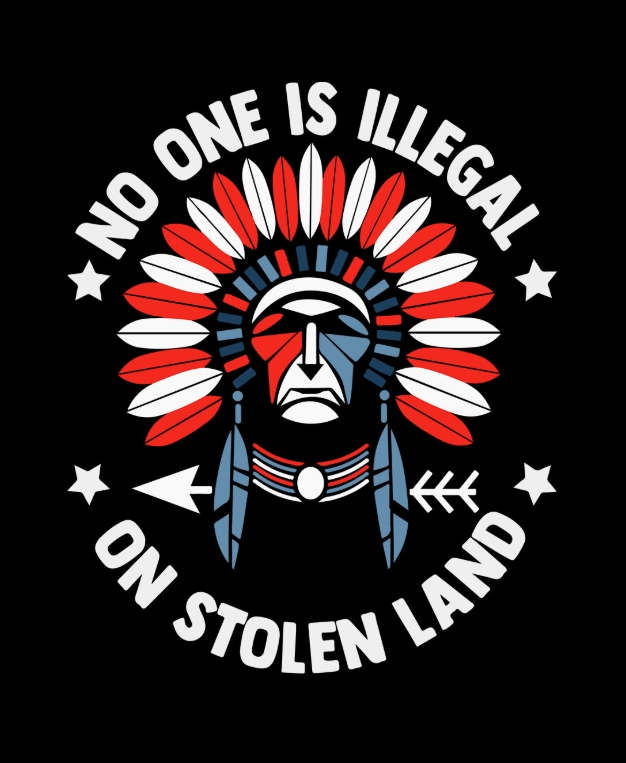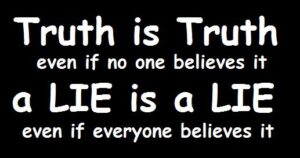Vendredi dernier, dans le centre-ville de Montréal, une commémoration a eu lieu pour marquer les 35 ans du refus d’oublier des Mohawks de Kanehsatà:ke et Kahnawà:ke le siège de 1990. À la mi-été 1990, la communauté mohawk de Kanehsatà:ke faisait chaque soir la une des nouvelles nationales. Dans ce que les médias ont appelé « la crise d’Oka », la communauté et sa communauté sœur voisine de Kahnawà:ke étaient toutes deux assiégées. Plus tôt dans l’été, la communauté allochtone voisine d’Oka avait cherché à agrandir un terrain de golf dans « les Pins », une zone boisée considérée comme sacrée par la communauté de Kanehsatà:ke et le site d’un cimetière ancestral. Des mois de tensions croissantes ont conduit à un barrage routier et à un échange de coups de feu entre les résidents et la Sûreté du Québec, au cours duquel un policier a été tué. Après cela, le gouvernement canadien a envoyé 4 000 soldats pour réprimer le soulèvement. « Nous n’oublierons pas », dit Katsi’tsakwas Ellen Gabriel. « Et ce n’est pas quelque chose à oublier, car ça n’a pas été réglé. » En tant que porte-parole de sa communauté, Gabriel, membre du Clan de la tortue, est devenu pour beaucoup le visage et la voix de la résistance communautaire au cours de cet été-là. Gabriel faisait partie de ceux qui s’étaient rassemblés à la Place du Canada, à Montréal. Au pied du piédestal vide d’où les manifestants antiracistes ont déboulonné la statue de John A. MacDonald en 2020, les Mohawks et leurs partisans se sont rassemblés pour se souvenir. Au cours des 35 années qui ont suivi, elle est restée l’une des figures les plus étroitement associées à la protection de Kanehsatà:ke et de sa culture, de ses langues et de ses pratiques traditionnelles. Lorsque d’autres évoquent l’année 1990, Gabriel se souvient de l’impasse qui a duré 78 jours entre sa communauté et les Forces armées canadiennes. Elle se souvient également du décès de l’agent Marcel Lemay, de la SQ. « Ce n’est pas une célébration pour nous, en tout cas pour moi, car Marcel Lemay a été tué pour un terrain de golf » dit-elle. « Vous savez, un homme a perdu la vie. Pour moi, c’est donc une commémoration, d’autant plus que nous avons été pris pour cible et que nous avons failli être tués par la Sûreté du Québec. » Ellen Gabriel, porte-parole de Kanehsatà:tke pendant le siège, revient sur ces 35 dernières années. | Photo : Archives APTN Les années précédentes, cette cérémonie se déroulait à Kanehsatà:ke, mais pour le 35e anniversaire, elle a été déplacée pour la première fois au centre-ville de Montréal, où des membres de Kanehsatà:ke et de Kahnawà:ke étaient présents. « En venant à Montréal », explique Wanda Gabriel, cousine d’Ellen, « nous pensions que notre voix serait plus forte, que nous aurions plus d’espace pour attirer l’attention, lancer des appels à l’action et nous aider à aller de l’avant à Kanehsatake. » Au moment du siège en 1990, Wanda était une jeune mère qui voyait sa cousine devenir une figure nationale en tant que porte-parole de leur communauté. Elle est d’accord avec Ellen Gabriel que la défense du territoire de Kanien’keha:ka ne s’est pas terminée en 1990. En savoir plus : Une demande d’excuses fédérales pour les événements de la crise d’Oka, 34 ans plus tard Ellen Gabriel, la première Autochtone à remporter le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal « Nous appartenons à la terre, vous savez, elle ne nous appartient pas, » souligne Ellen Gabriel. « Et donc, le conflit territorial qui dure depuis plus de 300 ans et qui n’a toujours pas été résolu 35 ans plus tard, je pense qu’il est vraiment important que les gens en prennent conscience et le comprennent. […] Et comment allons-nous mettre fin au vol des terres ? Parce qu’ils continuent. Vous savez, ils sont implacables. » Elle dit que Kanehsatà:ke continue d’être menacée par l’accaparement du territoire. « Nous ne sommes pas encore sortis du bois », prévient-elle. « Et il y a encore des gens qui veulent développer. Il y a la mine de niobium que certains veulent rouvrir. » Ghislain Picard a occupé pendant plus de 30 ans le poste de chef régional de l’APNQL. Il a été élu pour la première fois à ce poste à la suite du siège de 1990. L’ancien chef régional de l’APNQL, Ghislain Picard, prend la parole lors de la commémoration du siège de 1990. | Photo : Archives APTN S’adressant à la foule rassemblée pour commémorer l’événement, il affirme que les événements de 1990 ont eu un impact considérable sur tous les peuples autochtones. « Ce qui a contribué à la crise, le stand-off de 80 jours à peu près là, c’est une question qui est toujours pas résolue aujourd’hui », dit-il. « C’est une question de terres. Et pour moi, c’est très significatif sur euh finalement les devoirs que les gouvernements ont d’être à l’écoute et de livrer par rapport aux revendications des peuples autochtones. » Certaines personnes présentes à l’événement ont souligné qu’elles ne se contentaient pas de commémorer les 35 ans écoulés depuis 1990 ; elles exigent également que des mesures concrètes soient mises en œuvre. Il s’agit notamment du respect de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), de la création d’un fonds communautaire pour la guérison et de la restitution des terres. « Un autre appel à l’action, pour moi, c’est que cet événement si important s’est produit dans ce pays en 1990. Et il ne figure pas dans les livres d’histoire », affirme Wanda Gabriel. « Il ne figure pas dans les livres d’histoire du Québec. Il ne figure pas dans les livres d’histoire du Canada. Il ne figure même pas dans nos propres livres d’histoire communautaires. J’aimerais beaucoup le voir figurer dans nos livres d’histoire afin que les gens puissent connaître et comprendre les implications de ce qui s’est passé. » Pourtant, même après tout ce temps, le conflit fondamental qui a conduit à la « crise d’Oka » n’a jamais été véritablement réglé, et encore moins résolu. « Et donc, le conflit territorial qui dure depuis plus de 300 ans et qui n’a toujours pas été résolu 35 ans plus tard », dit Ellen Gabriel. « Je pense qu’il est vraiment important que les gens en prennent conscience et le comprennent. » Continue Reading
Le siège de Kanehsatà:ke commémoré pour la première fois à Montréal

Leave a Comment