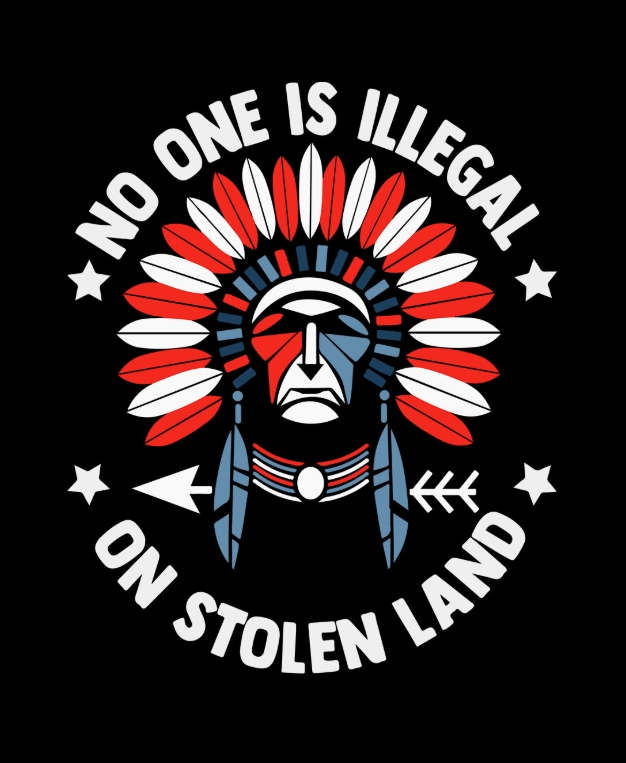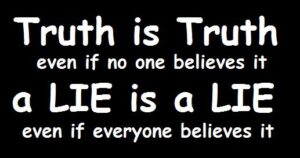Alors que la pression monte contre le projet de loi 97, qui a pour but une mise à jour des pratiques forestières au Québec, les ministres provinciaux des Relations avec les Autochtones et des Ressources naturelles ont interrompu leurs vacances cette semaine pour se rendre à La Tuque. Leur visite fait suite à des mois de manifestations qui ont culminé la semaine dernière avec une confrontation tendue entre des manifestants atikamekw et des bûcherons. Mardi, Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, et Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ont déclaré avoir rencontré les dirigeants des trois communautés atikamekw près de La Tuque. Mercredi, les ministres ont rencontré le chef régional François Verreault-Paul et d’autres dirigeants de l’Assemblée des Premières Nations Québec et Labrador (APNQL). Cette réunion était remarquable, car, moins d’un mois auparavant, l’APNQL avait suspendu les discussions avec le gouvernement du Québec sur cette question, affirmant que Blanchette Vézina avait « persisté à refuser de s’engager clairement sur un processus adéquat ». Le projet de loi 97 propose des changements radicaux dans l’organisation de la foresterie au Québec, et les opposants autochtones affirment qu’il menace de privatiser leurs terres ancestrales. Le projet de loi est à l’origine de vives protestations depuis son introduction en avril. En savoir plus : L’opposition au projet de loi 97 sur la foresterie prend de l’ampleur La visite des ministres fait suite aux affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière entre des militants atikamekw (dont beaucoup se considèrent comme des défenseurs de la terre et des chefs héréditaires) et des bûcherons non autochtones. Des images et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré des confrontations directes ainsi que, dans un cas, ce qui semblait être un bûcheron conduisant un camion lourd très lentement vers un défenseur des terres qui se tenait sur le chemin du véhicule. Le territoire des Atikamekw, connu sous le nom de Nitaskinan, est situé dans la partie centrale du Québec, à environ cinq heures au nord de Montréal. Les actions menées dans la région ont incité divers groupes à appeler à la paix. Le conseil de bande de la Nation Atikamekw de Wemotaci a publié une déclaration appelant au calme. Cette déclaration soulignait que le conflit s’étendait aux réseaux sociaux et insistait sur la nécessité « de respect et de retenue ». Un bûcheron dans une confrontation avec Dave Petiquay, défenseur des terres des Premières Nations MAMO. Capture d’écran tirée d’une vidéo de Lisanne Pittikwi, Facebook L’entrepreneur forestier Rémabec a publié son propre appel au « dialogue respectueux », saluant la déclaration du conseil municipal de Wemotaci. L’entreprise, dont le siège social est situé à La Tuque, près de Wemotaci, a demandé aux entrepreneurs forestiers d’éviter les sites bloqués sur la route 25, qui relie les deux communautés. Au début de la semaine, l’APNQL a appelé les dirigeants québécois à revenir à la table des négociations, exhortant le gouvernement du Québec dans un communiqué de presse à assumer ses responsabilités face à la détérioration de la situation et à « obtenir les conditions nécessaires à un dialogue réel et constructif ». Dans le même temps, cependant, les défenseurs des terres lançaient des appels sur les réseaux sociaux pour demander des renforts afin de se joindre à leur manifestation pacifique, tandis que les bûcherons tentaient également de rallier des partisans en vue d’une éventuelle confrontation. Une telle altercation n’a pas eu lieu et, depuis la fin de semaine dernière, une paix provisoire règne sur le terrain, ouvrant la voie aux réunions entre les Premières Nations et les dirigeants provinciaux. Retour à la table À la suite de la rencontre avec les dirigeants Atikamekws, Lafrenière et le Conseil de la Nation Atikamekw (représentant les communautés de Wemotaci, Opitciwan et Manawan) ont publié des déclarations optimistes. « Une chose est claire : nous sommes tous d’accord qu’il est plus qu’essentiel de modifier le régime forestier », Lafrenière a déclaré dans son communiqué, « en y apportant notamment des modifications pour prendre en compte les droits des Premières Nations. » Lafrenière a indiqué que les réunions avec les nations Atikamekw se poursuivraient dès la semaine prochaine. Le Conseil de la Nation Atikamekw a réaffirmé son opposition au projet de loi 97, mais a indiqué que les discussions entre les conseils Atikamekw et le gouvernement du Québec seraient relancées et que des réunions communautaires auraient lieu dans les communautés Atikamekw afin « d’établir collectivement les orientations à privilégier en matière de foresterie ». De plus, le Conseil a annoncé la mise en œuvre d’un projet pilote entre la Nation Atikamekw (y compris les chefs territoriaux non élus) et les entreprises forestières afin « d’expérimenter de nouvelles pratiques forestières respectueuses des valeurs atikamekw et alignées sur les objectifs nationaux ». Enfin, le Conseil a déclaré que toutes les parties avaient convenu d’apporter « des amendements importants au projet de loi 97 » afin de « parvenir à une véritable acceptabilité sociale et politique ». Blanchette Vézina a déclaré aux Nouvelles nationales d’APTN que les deux réunions avaient été constructives. Les ministres Blanchette-Vézina et Lafrenière se rendent à La Tuque pour discuter du projet de loi 97. Photo : Ian Lafrenière, Facebook Elle n’a pas souhaité commenter en détail la réunion avec l’APNQL, affirmant que la discussion était confidentielle, mais a souligné : « on est en bonne solution, autant les Premières Nations que nous-mêmes. » Une fois les modifications préparées, a-t-elle ajouté, une annonce officielle sera faite. La réunion des ministres avec le Conseil de la Nation Atikamekw, ainsi qu’avec des dirigeants individuels, a été plus complexe, d’autant plus qu’elle comprenait également des représentants de l’industrie forestière. « L’objectif de cette rencontre-là, ça a été de convenir de certaines choses », a déclaré Blanchette Vézina à APTN. « D’un, d’utiliser les bons canaux de communication, et envoyer un message aussi d’appel au calme, donc de rester aussi mutuel entre les allochtones et les Autochtones, parce que c’est primordial, c’est la base de toutes choses. » Par ailleurs, cette réunion n’a pas inclus les chefs territoriaux Atikamekw, les superviseurs héréditaires des terrains de piégeage individuels sur le territoire Atikamekw. Cependant, Blanchette Vézina a vu un potentiel pour que ces dirigeants soient intégrés à la discussion grâce au projet pilote visant à unir les Premières Nations et l’industrie forestière. « Les Premières Nations dans les communautés se sont engagées à consulter les familles, les chefs de territoire, les membres des communautés pour améliorer, disons, la gouvernance en lien avec les consultations », a-t-elle expliqué. « En attendant que le régime forestier actuel soit modifié, ce projet pilote là va venir aider concrètement, je le pense, à la relation entre les chefs de famille, les chefs de territoire, membres des communautés, le conseil de bande et l’industrie forestière. » Position des Premières Nations MAMO Les représentants de l’organisation des Premières Nations MAMO, qui regroupe des défenseurs autochtones et des chefs territoriaux des communautés Atikamekw et Innu, étaient manifestement absents des réunions de cette semaine. Les membres des Premières Nations MAMO ont été à l’avant-garde de la lutte contre le projet de loi 97. Ce sont eux qui sont visibles dans les vidéos des affrontements diffusées en ligne. Cependant, le porte-parole de MAMO, André Pikutelekan, a déclaré que l’organisation aurait existé, que le projet de loi 97 ait été déposé ou non. « Nous, c’est de garder nos arbres, garder une forêt en santé », a déclaré Pikutelekan à APTN. « Il n’y a pas de négociation. Si on parle de négociation, c’est que le territoire ne soit pas touché. Notre but principal et presque unique, c’est la sauvegarde de la forêt des chefs de territoire. » Pikutelekan a souligné que la Loi sur les Indiens limite le pouvoir des chefs élus et des conseils de bande aux réserves. « En dehors de ça, les conseils de bande n’ont aucune autorité », a fait valoir Pikutelekan. « Mais les titres et les droits appartiennent aux familles qui occupent le territoire. Donc, que les ministres aient discuté avec les chefs de conseil de bande, quoi qu’ils décident, ça n’a aucune implication légale sur les droits des chefs de territoire. » Même si le projet de loi 97 n’a pas été à l’origine de la création des Premières Nations MAMO, a déclaré Pikutelekan, il a contribué à mieux faire connaître le groupe. « J’ai l’impression qu’au niveau environnemental, c’est peut-être la première fois où un groupe est aussi gros, bien organisé et catégorique sur la réelle protection du territoire. Tous les autres, j’ai vu, soit qu’ils ont abandonné, soit qu’ils ont mis de l’eau dans leur ventre, ils ont négocié ou ils ont perdu. Et c’est la première fois que je vois qu’il y a une certaine pureté dans les intentions. » Les Premières Nations MAMO, a expliqué Pikutelekan, n’ont aucune intention organisationnelle de travailler avec les conseils de bande, qu’ils considèrent comme intrinsèquement corrompus ou enclins à faire des compromis. Les chefs territoriaux impliqués dans MAMO sont libres de faire ce qu’ils veulent et de travailler avec les groupes de leur choix. Pikutelekan a déclaré que environ la moitié des chefs territoriaux de la région de Wemotaci sont impliqués dans MAMO. Pourtant, Pikutelekan ne prévoit pas une escalade de la situation. Bien que diverses voix aient averti que le conflit autour de la foresterie en général, et du projet de loi 97 en particulier, pourrait créer les mêmes conditions explosives qui ont déclenché le siège de Kanehsatake en 1990 (aussi appelé la crise d’Oka), Pikutelekan a déclaré que son organisation était et resterait pacifique, non armée et sans masque. Rester pacifique a joué en faveur de MAMO, a-t-il ajouté. Bien que les membres du MAMO aient été confrontés à certaines tactiques agressives, Pikutelekan a déclaré que leur approche non violente leur avait permis de gagner le soutien de divers groupes non autochtones, allant des chasseurs, propriétaires de chalets et vacanciers aux entrepreneurs et pourvoyeurs. De même, les entreprises forestières et les entrepreneurs ont insisté pour que leurs employés et sous-traitants se retirent et répondent à la paix par la paix. L’objectif final du MAMO va bien au-delà du rejet du projet de loi 97 : à la suite d’une série de décisions importantes rendues par la Cour suprême, Pikutelekan espère voir les Premières Nations et les chefs traditionnels du MAMO reconnus légalement. « Si on va en cours », a-t-il déclaré, « On est très positif sur le fait qu’on va probablement gagner la première instance, peut-être la deuxième aussi, mais en allant en cours suprême, on est pratiquement certain de gagner. Et ce gain-là va pouvoir toucher plein de communautés à travers le Canada, surtout dans les zones où il n’y a pas de traité. » « Ce n’est pas une question d’argent », a fait remarquer Pikutelekan, « c’est une question de protection territoriale, mais vraiment une vraie protection, pas du marchandage comme ça se fait toujours. » Continue Reading
Projet de loi 97 : Ministres, Premières Nations reprennent les négociations alors que les tensions montent

Leave a Comment