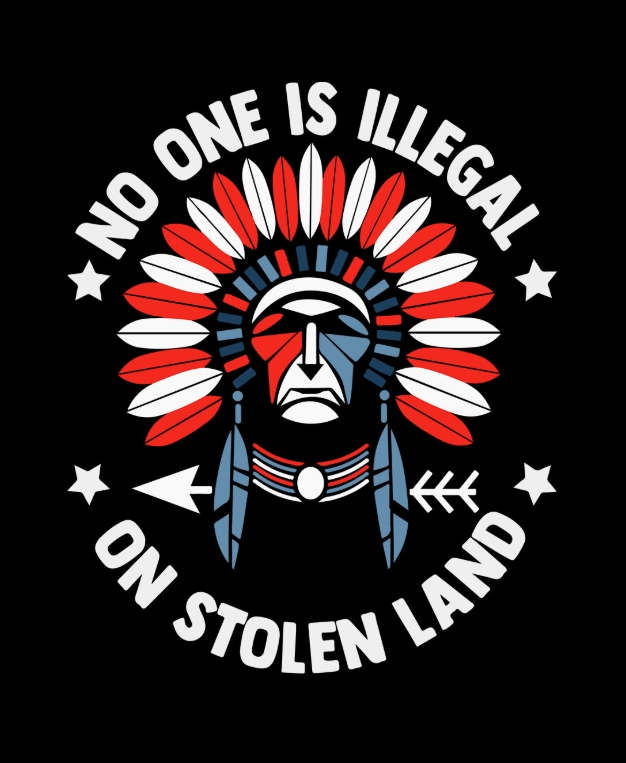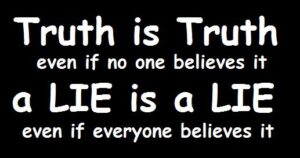La venue massive de chasseurs d’orignaux provenant de d’autres provinces pose de sérieux problèmes à la Première Nation Kebaowek, une communauté algonquine située dans l’ouest du Québec, près de la frontière avec l’Ontario. Selon Pascal Bibeau, directeur de la gestion des terres et des ressources de la Première Nation Kebaowek, le problème est aggravé par le fait que le gouvernement du Québec ne comprend pas la situation. « C’est comme si on disait à Québec : « le feu est pris », il nous disait : « Ouais, mais à grandeur de la province, c’est pas grave, c’est juste un petit feu. », a déclaré Bibeau à APTN Nouvelles nationales. « Mais ici, des maisons sont en train de brûler. » Pour Bibeau, les maisons incendiées représentent ce qu’il qualifie du nombre considérable e chasseurs d’orignaux entrant sur le territoire traditionnel de Kebaowek depuis l’Ontario et les États-Unis. La situation le dérange, lorsque certains suggèrent que l’affluence de chasseurs sportifs provenant de d’autres provinces, n’est pas une donnée considérable, pour l’ensemble du Québec. « Oui », dit-il, « mais ils sont tous ici. » Kebaowek est situé au-dessus du parc Algonquin, au nord de Barrie, en Ontario. Il se trouve à moins de cinq heures de route de Toronto et d’Ottawa, à deux heures et demie de Sudbury et à 45 minutes de North Bay. Bien qu’il n’existe pas de chiffres officiels sur les chasseurs sportifs provenant de l’extérieur du Québec, Bibeau affirme que les anecdotes rapportées en grand nombre parlent tous d’un seul et même sujet. « Il y a de plus en plus de monde sur le terrain, parce que ça arrive en grand nombre de l’Ontario », a-t-il déclaré. « C’est un phénomène qu’on ne voyait pas avant. Ils ne sont pas chez eux. Ils ont moins de respect pour le territoire. On voit beaucoup de déchets laissés en forêt par les non-résidents. Ils ont moins d’éthique que des chasseurs qui sont autochtones et non-autochtones qui sont sur le territoire depuis des générations et qui ont tendance à respecter le territoire et la ressource. » Il a signalé que des groupes de huit ou dix chasseurs arrivaient de l’Ontario. « On en voit, il y en a des milliers ici », a-t-il souligné. « Un phénomène qu’on voit, on va se stationner à l’entrée des chemins forestiers, quelques jours avant l’ouverture de la chasse, puis on voit pratiquement plus de plaques ontariennes sur les camionnettes que de plaques québécoises. » En savoir plus : Chasse à l’orignal de nuit dans la réserve de Matane : Braconnage ou exercice des droits ? Mise à jour du moratoire de la chasse à l’orignal dans la réserve faunique La Vérendrye La question du sport et des chasseurs non autochtones est au cœur des préoccupations de la Première Nation Bloodvein, au Manitoba. Cette communauté a interdit aux non-Autochtones de chasser l’orignal sur son territoire traditionnel, après ce qu’elle qualifie d’années de chasse excessive qui ont réduit l’accès de la communauté à cette forme d’alimentation traditionnelle. La chef de la Première Nation Bloodvein, Lisa Young, a déclaré à APTN que l’année dernière, la communauté de 1 200 personnes a pu chasser un seul élan qu’ils ont dus se partager entre ses résidents. La décision de restreindre l’accès aux chasseurs non autochtones a suscité de vives critiques, qui se sont amplifiées depuis que le gouvernement du Manitoba a modifié la loi sur la faune sauvage, afin de créer officiellement une zone tampon autour des zones du territoire de la Première Nation Bloodvein en question. Les représentants de la Manitoba Wildlife Federation et de la Manitoba Lodges and Outfitters Association ont clairement rejetés la zone tampon, qu’ils qualifient d’hâtive et d’une cause potentielle d’un préjudice aux entreprises. Mais à Kebaowek, le conflit n’oppose pas les Premières Nations et les chasseurs non autochtones. En fait, Bibeau n’a pas tardé à affirmer qu’il existe déjà un équilibre bien établi entre ces deux groupes, qui semblent se comprendre mutuellement. « Même, on a des gens, là, qui chassent pratiquement ensemble », explique Bibeau. « Il y a un bon voisinage entre les autochtones et les non autochtones. Puis là, les chasseurs ontariens arrivent eux autres au travers. Ils ne connaissent pas les gens ici. Ils s’en vont partout. Ils envahissent les territoires traditionnels autochtones de chasse à l’orignal. » Première Nation algonquine Kebaowek dans l’ouest du Québec. Photo : domaine public. Il a souligné que l’origine du problème de la présence des chasseurs de l’Ontario part du fait que le Québec est en consultation avec les Premières Nations et les parties prenantes non autochtones en vue d’élaborer un nouveau programme de gestion de l’orignal. Le dernier plan de gestion d’orignal a expiré en 2024, et le nouveau devait être présenté cette année. Il n’a pas encore été publié, bien que les consultations officielles se poursuivent. « C’est un mal nécessaire pour le provincial présentement de faire la consultation », a déclaré Bibeau, « mais on ne sent pas que c’est une vraie consultation. Notre message, on le donne, mais ils ne l’écoutent pas. » Entre-temps, les chasseurs affluent depuis l’Ontario, une province qui, selon Bibeau, impose des contrôles beaucoup plus stricts sur la chasse à l’orignal. Lorsque ces chasseurs arrivent au Québec, ils n’ont qu’à acheter un permis, contrairement aux chasseurs québécois non autochtones, qui doivent d’abord obtenir un certificat de chasse attestant qu’ils ont suivi des cours sur les armes et appris l’éthique et les meilleures pratiques de la chasse. « Puis, le chasseur ontarien, lui, ironiquement, il arrive et il n’a pas ça », a déclaré Bibeau. « Il peut acheter un permis quand même. Et puis, si un chasseur local se fait prendre à braconner, il perd son certificat du chasseur. Donc, il ne peut plus aller à la chasse pendant X nombre d’années. Mais le chasseur non résident, lui, il n’en a pas. Donc, il se fait prendre à braconner, mais il paye [l’amende]. Puis, l’année d’après, il est encore ici à chasser. » Lorsque les représentants de Kebaowek ont soulevé la question auprès du gouvernement provincial, Bibeau a déclaré que le Québec ne voulait pas écouter. « Ils ne veulent pas entendre parler de l’encadrement plus sévère des non-résidents », a-t-il affirmé. « Il y a des groupes de pression, des lobbies qui font un travail en ce sens. Et puis, c’est une question d’argent. C’est que les chasseurs ontariens, les non-résidents, ils payent le permis très cher. Et puis ça fait des revenus à l’échelle provinciale à Québec. » Selon le barème provincial des droits de permis de chasse, les chasseurs québécois doivent payer 88,67 $ pour un permis de chasse à l’orignal, tandis que les chasseurs non-résidents doivent payer 587,60 $ pour les mêmes droits de chasse. Shannon Chief, de la Première Nation algonquine de Barrière Lake, est membre du Anishnabe Moose Committee, une organisation locale qui vise à gérer les orignaux dans les territoires traditionnels en utilisant les connaissances traditionnelles. Elle a souligné que la réserve faunique de La Vérendrye compte à elle seule 55 secteurs dans lesquels les chasseurs peuvent obtenir un permis (bien qu’il y ait actuellement un moratoire sur la chasse à l’orignal à La Vérendrye en raison d’une faible population d’orignaux). « Et si vous multipliez cela par tous les différents secteurs au Québec », a-t-elle déclaré, « cela représente environ deux millions de dollars générés par l’élan ». Mais cet argent ne revient pas aux communautés locales, a souligné Bibeau. Il est plutôt transféré au gouvernement provincial à la ville de Québec. Cependant, la communauté de Kebaowek ne cherche pas à obtenir une part des revenus. « Même s’ils nous offraient d’avoir des retombées ou de retourner une partie de ces argents-là perçut auprès des non-résidents par la bande de permis, on préfère avoir moins de non-résidents », a déclaré Bibeau. « On considère que le territoire et la ressource n’est plus capable d’accueillir autant de chasseurs. » Les gardiens territoriaux surveilleront les zones de chasse Alors que la province tire des revenus de l’orignal, Bibeau a déclaré que le Québec avait également réalisé des économies en fermant des bureaux régionaux de protection de la faune. Un article paru par Radio-Canada suggère que le Québec aurait fermé ou considérablement réduit les effectifs de 30 des 68 bureaux de ce type répartis dans toute la province. « Quand il y a du braconnage, on n’a plus personne à qui s’adresser », a-t-il déclaré. « Il y a un numéro 1-800, mais là, c’est à Montréal. Donc, il n’y a pas de personnes locales. » Une solution pour pallier à la réduction du nombre d’agents de protection de la faune consiste à multiplier les yeux sur le terrain. C’est ce que l’organisation de Chief souhaite mettre en place. Une solution proposée par le Anishnabe Moose Committee consiste à mettre en place des « gardiens territoriaux », soit des membres des Premières Nations algonquines/anishinaabes de l’ouest du Québec et qui agiraient comme les yeux et les oreilles des communautés sur le territoire. « C’est quelque chose qui est en préparation depuis longtemps », a déclaré Chief. « Il reste encore beaucoup de formation à dispenser, mais ce n’est qu’un début pour eux de parcourir le territoire afin de surveiller [les activités]. Nous avons ces gardiens pour pouvoir simplement observer, signaler, surveiller, puis construire au fur et à mesure. » Les premiers gardiens pourraient être sur le terrain dès la semaine prochaine, ce qui, espère Chief, contrebalancerait la présence des représentants du Québec, qui dictent aux Algonquins ce qu’ils doivent faire sur leur territoire traditionnel. Pour Bibeau, une solution immédiate consisterait simplement à limiter la chasse sportive sur le territoire traditionnel de Kebaowek aux Algonquins et aux habitants non autochtones, ainsi qu’aux chasseurs du Québec, mais il est peu probable que la province interdise tous les chasseurs provenant de l’extérieur de la province. Une deuxième solution suggérée par Bibeau consiste à exiger que tous les chasseurs non autochtones travaillent avec un pourvoyeur. Il a affirmé que Kebaowek demande que les pourvoyeurs deviennent obligatoires dans le nouveau plan de gestion de l’orignal du Québec. « On a des membres qui sont propriétaires de pourvoiries », a-t-il déclaré. « On a des membres qui sont guides de chasse et pêche en pourvoirie. Ça représente des belles retombées économiques. Ça serait un meilleur encadrement. Ça limiterait le nombre. » Bibeau n’est toutefois pas optimiste. Bien qu’il ait fait état de relations positives avec les représentants locaux et régionaux du ministère, il a déclaré que le défi consistait à faire passer le message à Québec. « C’est une fin de non-recevoir à Québec. Ils ne veulent pas entendre parler de l’encadrement plus sévère des non-résidents. » APTN a contacté le ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec, mais n’a reçu aucun retour de leur part dans les délais de publications. Continue Reading
La Première Nation Kebaowek souhaite que le Québec interdise la chasse à lorignal aux chasseurs provenant dautres provinces

Leave a Comment