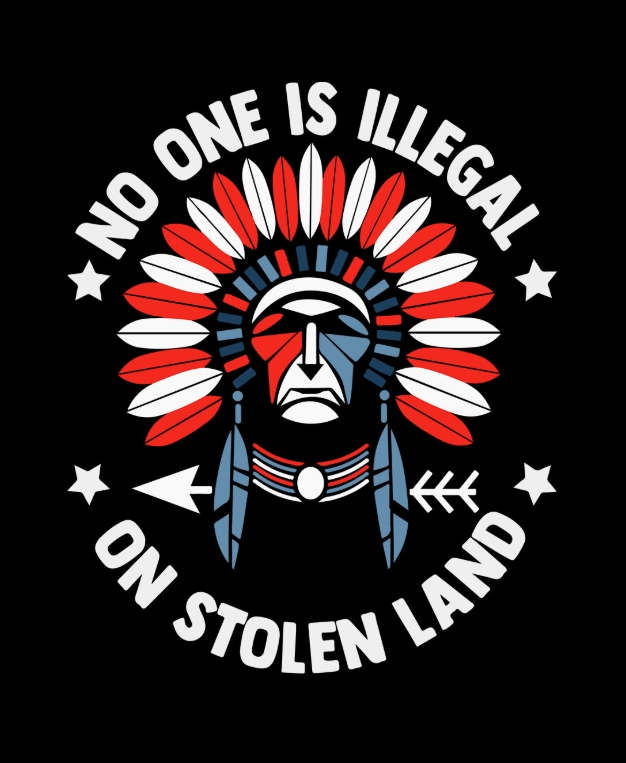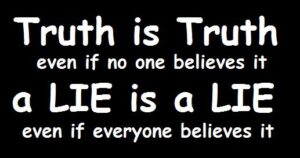L’événement marquant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation s’est déroulé à Montréal, au pied du mont Royal. Sous un soleil radieux une foule s’est rassemblée pour écouter les orateurs et défiler jusqu’au bureau du premier ministre. Fay Virginia Desjarlais a participé à l’événement comme traductrice et marcheuse, mais, comme beaucoup dans la foule, elle portait elle aussi une histoire traumatisante qui l’avait menée jusque-là. Tout a commencé avec son nom : Elle a déclaré à APTN Nouvelles nationales être née en Saskatchewan, de parents issus des Premières Nations Muskowekwan et Pasqua, et avoir reçu le prénom Fay. Sa mère, survivante d’un pensionnat indien, l’a donnée en adoption pendant la rafle des années 60. Elle a ensuite grandi au Québec dans deux familles adoptives. « Mon nom de gouvernement, c’est Elisa Garnier, » explique Desjarlais. « Mais, quand j’ai rencontré ma mère en 2007, elle m’appelait Fay, parce que c’est le nom qu’elle m’avait donné. Puis, c’est ça, elle est décédée pas longtemps après. Donc là, dans une cérémonie, j’ai décidé que les gens m’appelleraient Fay pour honorer ma mère, qui a dû laisser ses enfants, puis vivre des traumatismes liés à ça. » Ayant grandi à Sherbrooke, elle a affirmé que sa sœur et elle étaient les seules Autochtones de la région — et sans doute les deux seules survivantes de la rafle des années 60. « Quand j’ai grandi, on ne parlait pas de ça », dit-elle. Après avoir déménagé à Montréal dans les années 2000, elle a commencé à travailler avec Femmes autochtones du Québec, où elle a découvert qu’elle partageait des expériences communes avec d’autres femmes autochtones. « À ce moment-là, je ne savais pas que c’était des mesures d’assimilation pour nous enlever notre culture, notre identité. Je ne le savais pas. Ça m’a ouvert les yeux. C’est ça qui m’a amenée à aller retrouver ma mère. » Elle travaille aujourd’hui auprès de femmes incarcérées, de femmes en situation d’itinérance et de celles œuvrant dans l’industrie du sexe.Elle affirme que venir en aide aux femmes dans le besoin est un hommage à sa mère. « Quand je l’ai rencontré en 2007 » souvient-elle, « quand elle racontait ce qu’elle avait vécu, elle se faisait dire qu’elle n’était pas une bonne mère. C’est souvent ce que j’entends dans les histoires. » Événement organisé dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au parc du Mont-Royal, à Montréal. Photo : APTN/Jesse Staniforth Courtney Papigatuk, originaire de Salluit au Nunavik, a défilé avec sa cousine Courtney Ray, originaire du territoire mohawk de Kahnawake. « Nous avons tous perdu des êtres chers », a déclaré Papigatuk. « Il est vrai que chaque enfant compte, mais il est évident que tout le monde ne le pense pas, alors nous sommes ici pour le faire savoir. » Pour Ray, il est essentiel que le 30 septembre demeure une journée de commémoration — non seulement pour les enfants qui ne sont jamais rentrés des pensionnats, mais aussi pour ceux et celles qui vivent encore avec les traumatismes transmis par un système génocidaire ayant tenté d’anéantir plusieurs générations de familles autochtones. En savoir plus : Un entretien avec «celui qui raconte» : Richard Ejinagosi Kistabish Mélissa Mollen Dupuis co-anime l’événement télévisé « Se Souvenir des enfants » présenté par APTN « Le fait que nous soyons toujours là et que nous n’allions nulle part est révélateur », a déclaré Ray à APTN. « Ma grand-mère a fréquenté l’école indienne de Kahnawake et elle a perdu sa langue. Elle a perdu sa culture, et ce que la plupart des gens ignorent, c’est que cela affecte les personnes qui sont encore en vie. » Ray a déclaré qu’elle avait été réconfortée de voir pour la première fois des aînés en tête du défilé, montés sur un char afin de réduire la fatigue liée à la marche. « C’est vraiment symbolique, car ils peuvent voir qu’il y a encore des membres de la communauté et des non-Autochtones qui défendent cette cause importante », a-t-elle déclaré. « Nous continuons à trouver des tombes anonymes, et de plus en plus de gens se reconnectent à leur culture et comprennent vraiment que… c’est un moment émouvant, et nous devons rester unis. » Papigatuk a déclaré que la famille de sa mère avait été profondément traumatisée par la perte de ses arrière-grands-parents, tous deux survivants des pensionnats indiens, qui se sont suicidés. « C’est une réalité que certaines personnes sont des survivants », a-t-elle déclaré, « mais ils grandissent avec ce poids sur les épaules et ne peuvent pas le supporter. Et cela se transmet de génération en génération. Ma mère en est encore traumatisée, et cela me fait mal parce que je les aime tous tellement, vous comprenez ? » Les manifestants de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation descendent l’avenue du Parc à Montréal. Photo : APTN/Jesse Staniforth Thanakehrahne Kirby, qui a grandi entre les territoires mohawks d’Akwesasne et de Kahnawake, a défilé en brandissant le wampum à deux rangs, symbole de l’accord conclu par ses ancêtres avec les Européens pour voyager sur le même fleuve sans entraver la progression les uns des autres. « Cet accord stipule que nous suivons le même cours de la vie et que nous formons un seul peuple, que nous sommes humains », a-t-il expliqué. « Cet accord a été rompu. Les deux rangées ont été brisées. Les accords que nous avions conclus ont été rompus, et nous devons raviver ces accords que nous avons conclus les uns avec les autres. » Il a déclaré qu’il devait son lien avec sa culture à la volonté de ses ancêtres de se battre pour protéger leur peuple. « Lorsque [ma grand-mère] a donné naissance à ma mère », a-t-il déclaré, « elle était un peu déboussolée parce que c’était son premier enfant. Une femme de l’Armée du Salut, ou d’une autre organisation similaire, a essayé de la convaincre de signer un document qui aurait permis de lui retirer ma mère. Et ma grand-mère a fini par dire : « Non, non ! » Le lendemain, elle a obtenu qu’une des tantes de ma grand-mère la conduise et elle s’est enfuie. Mais je ne serais pas là aujourd’hui, car ma mère aurait été emmenée et assimilée. » Aujourd’hui, Kirby parle sa langue et raconte avec aisance l’histoire et les croyances de son peuple. Il fait partie de la tradition des guerriers mohawks. « Ce n’est pas que nous soyons des terroristes », dit-il. « Nous protégeons les voix qui ne peuvent s’exprimer. Nous devons défendre les êtres à quatre pattes. Nous devons défendre les arbres. Nous devons défendre toute la création et parler en leur nom, car nous devons reconnaître et remercier les remèdes qui proviennent du sol et de la terre naturelle. Notre langue décrit que la Terre mère nous soutient, nous et nos corps. » Desjarlais constate que la communauté autochtone urbaine de Montréal s’agrandit, mais remarque que ses besoins augmentent également. « Il y a beaucoup de travail à faire », dit-elle. « La communauté à Montréal, on est quand même 40 000 personnes. Les besoins grandissent. Beaucoup de gens reviennent à Montréal, dans les villes partout. » Pour Desjarlais, l’expression de solidarité qui s’est manifestée aujourd’hui est également l’expression d’un besoin éprouvé par une communauté plus exposée que toute autre à la pauvreté. « Les financements pour des services, d’avoir plus d’employés, c’est important que le gouvernement s’ouvre les yeux et donne le financement qu’on a besoin pour continuer à donner des services qui vont aider la communauté et qui vont créer moins de n’importe quoi au centre-ville. » Continue Reading
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation commémorée à Montréal

Leave a Comment