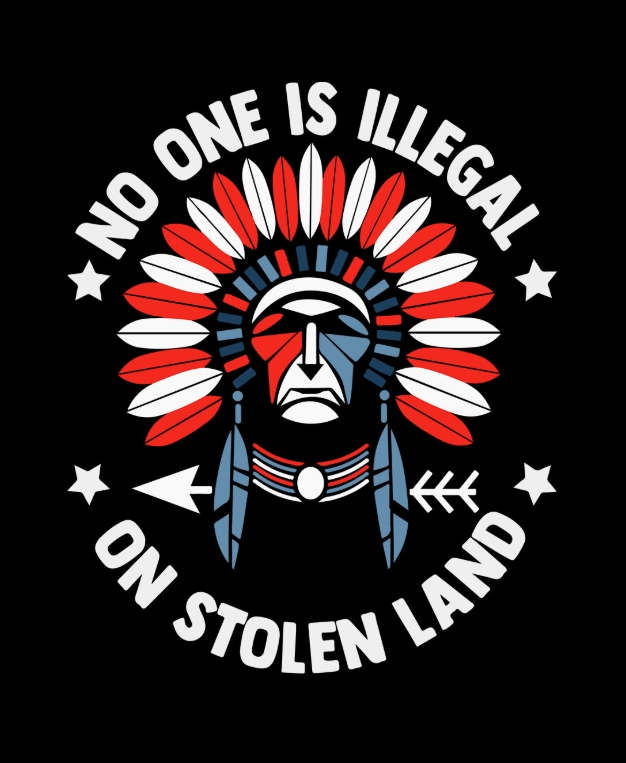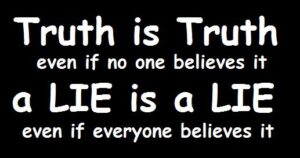Il y a quelques semaines, à Pond Inlet, au Nunavut, le fils de Rhoda Katsak a abattu deux phoques, un petit et un plus grand. Il les a ramenés à la maison et la famille a bien aimé la viande du jeune phoque. « Un jeune phoque ou un phoque plus petit, est plus délicat », a déclaré Rhoda Katsak à APTN News. « La viande est plus tendre. » Ils ont mangé le premier phoque pendant plusieurs jours, avant de passer au plus grand. C’était tout un défi, parce que la viande de phoque adulte est loin d’être aussi agréable à manger. Katsak affirme que son mari a eu l’idée de faire une publication sur Facebook indiquant qu’un grand phoque était disponible et invitant les gens à venir chercher de la viande pour nourrir leurs chiens. Ils ne s’attendaient pas à ce que les gens veuillent en manger eux-mêmes. « Ce n’est pas quelque chose que nous donnerions normalement à quiconque parce que ce n’est pas une option, du moins pour notre groupe d’âge », dit-elle. « En dix minutes, nous avions tout donné. Les gens sont venus chercher de la viande. Ils s’en fichaient complètement. Ils voulaient de la nourriture. » Pour Katsak, c’est un indicateur du désespoir des membres de sa communauté en ce qui a trait à l’accès à la nourriture, en particulier aux aliments traditionnels. Son expérience n’est pas unique. Partout au Nunavut, des spécialistes locaux affirment que les Inuits peinent à se nourrir. L’urgence liée à la faim dans le Nord Au Nunavut, le problème de la faim n’a rien de nouveau, a déclaré Jessica Penney. « [C’est] un problème qui a pris de l’ampleur au cours des dernières années. Les statistiques sur l’insécurité alimentaire dans les communautés inuites sont désastreuses depuis de nombreuses années », dit-elle. Penney, un Inuk du Nunatsiavut qui a grandi à Iqaluit, est professeure adjointe en sociologie à l’Université métropolitaine de Toronto. Au cours des trois dernières années, elle a participé aux côtés de Katsak à un projet appelé « Inuksiutit :La souveraineté alimentaire au Nunavut », dirigé par le programme de recherche Canada-Inuit Nunangat-Royaume-Uni dans l’Arctique (CINUK). Penney a été chercheuse associée dans le cadre du projet Inuksiutit, tout comme Katsak, qui a grandi en partie sur le territoire, a étudié dans un externat fédéral et a ensuite été directrice régionale du développement économique pour le gouvernement du Nunavut de 2005 à 2020. Le projet, qui portait sur les communautés de Pond Inlet/Mittimatalik et d’Arviat, visait à déterminer les facteurs clés de la souveraineté alimentaire et à informer les Inuits sur la façon d’améliorer l’accès aux aliments traditionnels. À la suite de la réalisation du projet, Penney a dirigé l’élaboration de la trousse d’outils Inuksiutit du Yellowhead Institute, qui a façonné l’information du projet Inuksiutit pour créer un récit interactif Story of the Seal sur l’histoire du phoque, explorant le rôle crucial du phoque dans la culture des communautés inuites. La menace de l’insécurité alimentaire a été le moteur du projet Inuksiutit et a également permis au Yellowhead Institute de transformer l’information du projet en une expérience d’apprentissage interactif. La trousse d’outils Inuksiutit comprend des vidéos d’atelier d’experts du grand projet Inuksiutit, dans lesquelles Katsak et son mari enseignent les techniques traditionnelles de chasse et de coupe de viande du phoque, de mise en cache de la viande de phoque pour la fermentation, de conservation de la viande dans une peau de phoque et de cuisson de chaque partie du phoque selon les coutumes. Phoque frais, tiré des vidéos pédagogiques sur la chasse traditionnelle préparées par Rhoda et Joshua Katsak dans le cadre du projet Inuksiutit. Photo : Rhoda Katsak Amy Caughey, d’Iqaluit, une autre chercheuse associée au projet Inuksiutit, est nutritionniste en santé publique et possède plusieurs décennies d’expérience au Nunavut. Elle a étudié le rôle des aliments traditionnels inuits dans la communauté et leur relation avec la santé au cours des premières années de la vie. Caughey explique la différence entre la « sécurité alimentaire », le fait de pouvoir accéder à de la nourriture et la « souveraineté alimentaire », le fait de pouvoir manger des aliments pertinents sur le plan culturel que les gens aiment. « La distinction est très importante », affirme Caughey, « et au Nunavut, les organisations inuites et les travailleurs inuits de la santé ont déclaré que la souveraineté et la sécurité alimentaires signifient avoir accès à des aliments traditionnels et au système alimentaire traditionnel. » Selon Caughey, l’absence d’aliments traditionnels est une caractéristique clé de l’insécurité alimentaire, qui est également associée au coût élevé de la nourriture dans les magasins. « Les personnes en situation d’insécurité alimentaire sont plus susceptibles d’être en moins bonne santé », explique Caughey. « Elles ont plus tendance à souffrir de maladies infectieuses, de mauvaise santé buccodentaire, de maladies chroniques et de problèmes de santé mentale. Elles sont hospitalisées et séjournent plus longtemps à l’hôpital. » « Et on constate qu’au Nunavut, nous avons un défi important en matière d’insécurité alimentaire pour les adultes et les enfants. Cela s’ajoute aux nombreux autres défis que nous devons relever. Par exemple, la tuberculose. Un élément important de la tuberculose est en fait le foyer dans lequel vous vivez, la nourriture à laquelle vous avez accès. Il y a plusieurs éléments liés à l’insécurité alimentaire. » Caughey affirme que le projet Inuksiutit visait à utiliser les connaissances inuites sur les systèmes alimentaires traditionnels pour lutter contre l’insécurité alimentaire tout en renforçant la santé de la communauté et les liens avec les cultures traditionnelles. « Les aliments traditionnels sont associés à une bonne santé mentale et à un sentiment d’appartenance la communauté, ainsi qu’à tous ces concepts très puissants que nous considérons comme de très bonnes choses », dit-elle. « C’est particulièrement important au Nunavut, car les aliments traditionnels sont évidemment très étroitement liés aux animaux et aux humains, à l’environnement et à l’endroit où tous ces éléments sont réunis. » Des jeunes à Pond Inlet, au Nunavut, apprennent à mettre en cache la viande de phoque pour la fermentation. Photo : Rhoda Katsak Sonner l’alarme La gravité de l’insécurité alimentaire au Nunavut a donné lieu à une conférence de presse le 29 septembre au Qajuqturvik Community Food Centre (QCFC) d’Iqaluit. Joseph Murdoch-Flowers, directeur général du QCFC, affirme que le centre a récemment servi 639 repas en une seule journée, ce qui représente 8 % de la population totale d’Iqaluit. Il mentionne également que le nombre de repas servis augmente chaque année, en hausse de 16 % entre 2022 et 2023 et de 4 % entre 2023 et 2024. Le QCFC s’attend à dépasser le total des 70 000 repas servis l’an dernier au cours du mois. « Nous ressentons la forte pression que cela représente dans notre salle à manger et dans notre cuisine », a déclaré Murdoch-Flowers. Dr Sindu Govindapillai, directeur général de l’Arctic Children and Youth Foundation et pédiatre travaillant à Iqaluit, a souligné que 79 % des enfants de moins de 14 ans au Nunavut vivaient en situation d’insécurité alimentaire (selon les données de 2022 de Statistique Canada). « Nous traversons la pire crise en matière de sécurité alimentaire que j’ai vue jusqu’à présent », explique Govindapillai. « Nos patients, nos clients doivent prendre des mesures désespérées pour nourrir leurs enfants. » Repas prêts à être servis au centre alimentaire communautaire Qajuqturvik d’Iqaluit. Photo : QCFC/Facebook Ce désespoir ne se limite pas à Iqaluit, déclare Tracey Galloway, professeure d’anthropologie à l’Université de Toronto, qui a collaboré à la recherche avec Govindapillai. Galloway a mené une série d’entrevues dans la région de Kitikmeot, dans l’ouest de l’Arctique, en février dernier. « La faim était omniprésente », a-t-elle déclaré à APTN. « Tous ceux à qui j’ai parlé avaient épuisé toutes leurs stratégies locales pour se nourrir. Les armoires de cuisine étaient tout simplement vides. Et même les familles qui ont les ressources nécessaires et qui sont reconnues pour partager et donner régulièrement ne savaient pas quoi faire. » Galloway a fait l’éloge des stratégies locales de distribution alimentaire, qui comprennent la pêche et la congélation du poisson pour la communauté. « Ces stratégies, qui ont fonctionné pendant des années et des années, avaient atteint leurs limites. La population n’avait aucun recours. Les gens qui avaient passé leur vie à bâtir cette communauté en travaillant très fort les uns pour les autres étaient à bout de ressources. C’était horrible. » « Ils ne pouvaient rien faire de plus. Et ils avaient peine à survivre à la pire crise de la faim dont j’ai été témoin. » Galloway affirme que la situation s’est détériorée deux mois plus tard, en avril, lorsque Services aux Autochtones Canada (SAC) a mis fin au programme de bons alimentaires des hameaux de l’initiative de bons alimentaires dans les hameaux. La fin du programme de bons alimentaires dans les hameaux L’Initiative : Les enfants inuits d’abord reflète le principe de Jordan pour les communautés inuites, garantissant aux enfants inuits l’accès à un soutien en matière de santé, de services sociaux et d’éducation, ainsi qu’un financement de ces initiatives. L’Initiative a d’abord été prolongée d’un an en mars. « Au début, ils ont été très généreux avec le programme », a déclaré Katsak. « Ça a peut-être duré pendant trois ans, au cours desquels les familles avec des enfants de moins de 18 ans recevaient de la nourriture ou des bons alimentaires. Une personne avec plusieurs enfants recevrait au moins de 2 000 $ à 3 000 $ par mois. » « On voyait les retombées positives, les enfants étaient heureux. » En savoir plus : Un plan dans la capitale du Nunavut pour lutter contre l’insécurité alimentaire La gouverneure générale a porté des produits à base de phoque lors de son voyage en Allemagne Penney souligne que le programme, qui donnait aux familles des allocations mensuelles de 500 $ par enfant pour l’épicerie et de 250 $ par enfant de moins de 4 ans pour les couches, semblait fonctionner. « Nous avons des témoignages selon lesquels cela augmente l’engagement social, les enfants vont à l’école le ventre plein et les gens mangeant des aliments plus sains », dit-elle. Katsak affirme que le programme de bons alimentaires dans les hameaux a été abandonné complètement sans préavis. Cette dernière affirme : « Aujourd’hui, les gens ont beaucoup de difficultés à avoir suffisamment de nourriture pour leurs familles compte tenu des prix actuels. Les gens disent avoir de la difficulté à se nourrir, et à se procurer des aliments de base. » Dans une déclaration aux médias, Services aux Autochtones Canada soutient que l’Initiative : Les enfants inuits d’abord a été conçue comme un programme provisoire d’aide temporaire. « Il n’est ni prévu ni conçu pour remplacer l’aide financière du gouvernement par le biais de programmes « universels » tels que les bons alimentaires », déclare l’ISC. Selon Nunatsiaq News, l’agent de programme de SAC, Andrew Ouellette, a fait valoir dans une lettre que SAC n’approuverait pas le financement de programmes universels de bons alimentaires « en fonction de son analyse des obligations juridiques liées aux droits fondamentaux à l’égalité dans le cadre de l’Initiative : Les enfants inuits d’abord ». Ouellette ne semble plus être à l’emploi du gouvernement fédéral. Après avoir mis fin au programme de bons alimentaires dans les hameaux, SAC a demandé à chaque ancien bénéficiaire de bons de présenter une demande individuelle à l’agence pour obtenir de l’aide. En juillet, Penney, Galloway et Govindapillai se retrouvaient parmi une douzaine d’auteurs du rapport « Preliminary findings from an evaluation of the Hamlet Food Voucher Program in Qikiqtaaluk, Nunavut ». Les auteurs du rapport ont constaté qu’à la suite du retrait du financement du programme de bons alimentaires dans les hameaux, divers coordonnateurs ont aidé les familles à demander du soutien pour l’épicerie, mais que ce soutien « semble avoir été presque éliminé ». « Les coordinateurs de services ont parlé de refus généralisés des demandes d’aide alimentaire », indique le rapport. « Ils ont également signalé que presque toutes les demandes étaient transmises à l’échelle nationale pour examen ; les retards et l’augmentation des refus en réponse aux demandes transmises ont déjà été documentés. Certains refus ont été communiqués sans explication ; certaines familles ont reçu des messages indiquant qu’une explication serait fournie, mais elles n’ont reçu aucune autre communication. » Le professeur Nicholas Li, du département d’économie de l’Université métropolitaine de Toronto, est l’un des 12 coauteurs du rapport. « Les demandes individuelles sont devenues plus difficiles », dit-il. « Il y a davantage de refus et d’obstacles à surmonter pour obtenir [l’approbation]. Maintenant, les gens sont confrontés à la fois à une augmentation des prix et à l’épuisement d’une grande partie de leurs revenus. » Li ne considère pas le programme de bons alimentaires dans les hameaux comme une panacée et craint qu’il ne fasse rien pour s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité alimentaire. Il affirme, par exemple, que jusqu’à ce qu’il y ait davantage d’efforts pour réduire les coûts de transport des produits d’épicerie, les aliments demeureront hors de prix dans une région qui subit une importante inflation des prix des aliments. « Iqaluit affiche l’un des taux d’inflation les plus élevés de toutes les communautés », dit-il. « Je crois que les prix des aliments, qui étaient déjà très élevés, ont augmenté de 30 % à Iqaluit du premier trimestre de 2022 à la mi-2024. Nous avons également connu une inflation élevée des prix des aliments dans le Sud, mais au cours de cette période, on parle probablement de la moitié ou moins. « Les aliments qui étaient déjà deux fois plus coûteux [dans le Nord] le sont maintenant 2,3 fois plus. La situation a empiré. » Siège social de Services aux Autochtones Canada à Gatineau, au Québec. Photo : Archives APTN APTN Nouvelles nationales a demandé une entrevue à Services aux Autochtones Canada concernant la fin du programme de bons alimentaires dans les hameaux. Un porte-parole a déclaré que le gouvernement n’accordait pas d’entrevues sur la question, mais qu’il ferait une déclaration si APTN envoyait des questions par écrit. C’est ce qu’a fait APTN, mais la réponse de SAC ne répondait pas directement à nos questions sur les problèmes touchant la faim, y compris à savoir si SAC confirme qu’il y a une situation d’urgence alimentaire en cours dans le Nord. SAC a toutefois déclaré que « les initiatives à court terme comme l’Initiative : Les enfants inuits d’abord sont insuffisantes. C’est pourquoi Services aux Autochtones Canada travaille […] à renforcer les approches qui s’attaquent à l’insécurité alimentaire grâce à des initiatives comme Nutrition Nord et le programme d’alimentation en milieu scolaire. » Les limites du programme Nutrition Nord Li et Galloway ont étudié le programme fédéral Nutrition Nord Canada (NNC) pendant de nombreuses années et ont reçu des fonds du gouvernement pour la recherche. Li affirme que NNC est un programme complexe et multidimensionnel dont le succès ou l’échec peut être difficile à évaluer en raison de ses nombreuses ramifications. Le NNC a été lancé en 2011 par le gouvernement conservateur de l’ancien premier ministre Stephen Harper. Le programme vise à réduire le coût des aliments dans le Nord circumpolaire en subventionnant les détaillants dans l’espoir de faire baisser leurs prix. « Les détaillants du Nord et fournisseurs du Sud qui expédient des produits dans les communautés admissibles reçoivent un certain montant par kilogramme pour l’expédition des aliments », explique Li. « Le programme était utilisé à cette fin au cours des huit premières années. » Les communautés du nord de l’Ontario, du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest ont été ajoutées au programme par 2016, et, en 2019, le NNC a lancé la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés, tout en injectant des fonds pour la recherche. « Lorsque l’on regarde où va l’argent, on parle d’environ 144 millions de dollars par année, soit la subvention aux détaillants [qui vise] en grande partie à subventionner le coût d’entreposage des aliments », explique Li. « Mais il y a cette composante supplémentaire, depuis 2019, qui subventionne plusieurs choses. La Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs [et] la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés ne s’adressent pas aux particuliers, mais aux entreprises. Il pourrait donc s’agir d’une association de chasseurs et de-trappeurs. Ce pourrait être comme un programme alimentaire ou une ONG. » Li mentionne que les communautés peuvent utiliser la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés de différentes façons, comme pour investir dans des congélateurs communautaires ou des programmes de rémunération des chasseurs qui récoltent de la viande pour distribuer aux aînés. Il affirme qu’il est déchiré au sujet de NNC parce qu’il en voit les avantages. Il explique que le programme a été conçu en réponse à des demandes précises de longue date de la part des communautés pour aider ces dernières à améliorer leur souveraineté alimentaire et à mettre fin à leur dépendance à l’égard des aliments vendus en magasin. À son meilleur, NNC aide à renforcer les liens avec les cultures traditionnelles et à garder les chasseurs sur la terre. Des perdrix blanches données au centre alimentaire communautaire Qajuqturvik d’Iqaluit par un chasseur local. Photo : QCFC/Facebook « Il répond à un besoin réel de la part des communautés », déclare Li. Mais ce dernier affirme du même coup avoir de la difficulté à déterminer si le programme a atteint ces objectifs, principalement parce qu’il y a eu peu d’évaluation des programmes de NNC. « Il n’y a pas de documentation universitaire ou savante sur ce que font ces programmes », dit-il, « en partie parce qu’ils sont si variés et complexes et que certaines communautés en bénéficient, et d’autres non. Il n’y a pas vraiment de base de données systématique ni de normalisation des différentes façons de dépenser cet argent. » Li partage sa critique la plus accablante de NNC avec Galloway, à savoir que toutes les subventions ne parviennent pas aux communautés. « Nutrition Nord a toujours été décrit comme une subvention axée sur le marché », explique Galloway. « Mais les gens ne trouvent pas que les prix sont plus bas. Ils constatent plutôt que les prix sont élevés et continuent d’augmenter. Ils ne voient vraiment pas cette concurrence se traduire par des prix plus bas dans les communautés où il y a un environnement concurrentiel de vente au détail. Bien sûr, un certain nombre de communautés dans le Nord n’ont qu’un seul magasin. » En septembre 2023, Galloway et Li ont publié un article dans le Journal of Public Economics indiquant que les prix de détail n’étaient réduits que de 67 cents pour chaque dollar reçu en subvention, ce qui suggère que le tiers du financement du programme NNC était versé aux détaillants plutôt qu’aux consommateurs. Le rapport conclut que « les ressources destinées aux communautés marginalisées peuvent être interceptées en partie par les entreprises locales qui détiennent une position dominante sur le marché. » Les épiciers qui exploitent des magasins dans le Nord ont toujours soutenu qu’ils remettaient aux consommateurs l’entièreté des subventions qu’ils reçoivent du gouvernement fédéral. Pour expliquer que les prix demeurent élevés, les chefs de la direction qui ont comparu devant un comité parlementaire ont jeté le blâme sur le programme fédéral de remise sur le carbone, mieux connu sous le nom de taxe sur le carbone, qui a été annulé. « De façon générale, la majeure partie des subventions versées aux détaillants se traduit par des prix plus bas. L’idée selon laquelle le programme est inutile… je crois que le programme est parfois un excellent bouc émissaire. » Selon Li, les problèmes les plus pressants du programme NNC sont plus complexes. « Même si l’entièreté de la subvention était transmise aux gens dans le besoin, dans quelle mesure une subvention contribue-t-elle à la diminution de l’insécurité alimentaire mesurée? Et augmente-t-elle vraiment la consommation de ce type d’aliments nutritifs? » Et même si le programme pouvait être réorienté pour s’assurer de financer les aliments dont les personnes les plus défavorisées ont le plus besoin, celles-ci seraient tout de même confrontées au coût exorbitant du transport par avion de produits d’épicerie dans le Nord. Les aliments traditionnels : la solution dont tout le monde attend Le programme de recherche Inuksiutit : La souveraineté alimentaire au Nunavut et la trousse d’outils Inuksiutit connexe mettent l’accent sur le rôle essentiel des aliments traditionnels tout juste prélevés de la terre dans la souveraineté alimentaire et l’alimentation saine. « Le principe directeur du projet Inuksiutit et de la trousse d’outils Inuksiutit », a déclaré Penney, « est de veiller à ce que les jeunes aient les connaissances nécessaires pour manger des aliments traditionnels, les chasser et les apprêter. La trousse d’outils sert en quelque sorte à soutenir certaines de ces activités. On y aborde la chasse, la préparation et l’utilisation, et on y trouve des recettes avec les aliments que vous chassez et dépecez. » Caughey cite des recherches démontrant que les Inuits qui mangent des aliments prélevés de la nature consomment davantage de bonnes protéines, des bons gras et une gamme de vitamines et de minéraux, tout en ingérant moins de sodium et de gras malsains. « À bien des égards, les aliments traditionnels favorisent vraiment la santé et la sécurité alimentaire », dit-elle. « Ce sont des superaliments. Ils soutiennent une bonne santé, et c’est aussi ce que les gens aiment manger. » Bien qu’il ne manque pas de phoques, de baleines et même de caribous au Nunavut, les chasseurs n’ont pas l’argent nécessaire pour payer leurs dépenses liées à la chasse. Et ce, malgré l’investissement du programme NNC dans la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs. Rhoda Katsak, de Pond Inlet, au Nunavut, enseigne les méthodes traditionnelles de préparation du phoque dans le cadre du projet Inuksiutit : Souveraineté alimentaire au Nunavut. Photo : Rhoda Katsak « Peu de gens sont équipés pour la chasse », explique Katsak. « La plupart des personnes qui reçoivent une aide au revenu ou de l’aide sociale n’ont pas les moyens de chasser, parce que c’est trop dispendieux. Elles ne peuvent pas se le permettre. Pour certaines familles, il est très difficile de se procurer des aliments traditionnels. » Penney affirme que les armes à feu et les balles coûtent cher. Et l’on ne tient pas compte du coût d’une motoneige, d’un VTT ou d’un bateau et de la hausse constante du prix de l’essence. « Être en mesure d’accéder à des aliments traditionnels, comme le font maintenant la plupart des gens, coûte très cher », a déclaré Penney. « Dans ce genre de crise liée au coût de la vie, cela nuit également à la capacité d’accéder aux aliments traditionnels. » Katsak conteste aussi le fait que les motoneiges, les VTT et les moteurs hors-bord sont toujours classés comme produits récréatifs par le gouvernement canadien. « Les gens peuvent difficilement se le permettre », dit-elle. « Et le gouvernement ne se rend pas compte que ce qu’ils considèrent comme des véhicules récréatifs, pour nous, ce sont des machines agricoles. » Penney souligne que l’obstacle économique à la chasse n’est qu’une des raisons pour lesquelles de moins en moins d’Inuits développent des compétences traditionnelles pour la chasse. « Que ce soit la famille dans laquelle ils ont grandi qui ne pratique pas un certain type de chasse ou de rassemblement », dit-elle. « Ce pourrait aussi être un traumatisme intergénérationnel, ou des gens qui se sont retrouvés dans les pensionnats et qui n’ont pas acquis ces compétences, ou simplement la réalité de vivre dans [une communauté plus urbaine comme Iqaluit]. » Les changements climatiques limitent aussi la récolte d’aliments traditionnels. « Ils ont une incidence sur l’accès à la terre et [forcent les chasseurs] à raccourcir les saisons de chasse », a déclaré Penney. Caughey affirme que les changements climatiques ont non seulement changé le processus de chasse, mais aussi le processus de stockage et de préservation des aliments traditionnels. « Par exemple, si vous séchez du poisson, et que c’est plus pluvieux qu’auparavant, cela change la façon de faire. » Et c’est la même chose avec la fermentation des aliments. « Nous voulons faire en sorte que les gens aient les connaissances nécessaires en matière de fermentation, afin de conserver les aliments à une température fraîche pour assurer leur salubrité. » La meilleure voie à suivre Chaque personne à qui nous avons parlé souligne les causes fondamentales de l’urgence alimentaire dans le Nord et tous affirment qu’un changement réel de la situation nécessite des mesures à différents niveaux. De même, tous affirment que la clé pour répondre à la crise de la faim au Nunavut est la viande fraîche que l’on trouve sur la terre. Caughey, qui n’est pas Inuite, affirme que pour sortir de la crise, il faudra d’abord écouter les Inuits. Elle cite une étude qu’elle a menée qui révèle que les communautés étaient très heureuses du financement qu’elles ont reçu pour chasser les aliments traditionnels au cours des premières années de la pandémie de COVID-19. « Les exemples montrent que lorsqu’on investit des ressources dans les cueilleurs, lorsqu’on écoute les communautés, on est en mesure de fournir plus d’aliments traditionnels au sein de la communauté », dit-elle. « Il s’agit simplement d’écouter les communautés, ce qu’elles souhaitent et ce qu’elles considèrent comme des solutions. » Katsak considère le soutien aux chasseurs comme une mesure essentielle. « La chasse est le principal moyen de subsistance dans cette communauté, comme dans toutes les communautés du Nunavut », dit-elle. « Les gens ne peuvent pas se procurer un approvisionnement en bœuf pour une année. De toute façon, personne n’a les moyens de s’acheter du bœuf. Donc, peu importe l’argent qu’ils ont, tout surplus est consacré aux dépenses liées à la chasse. Qu’il s’agisse de munitions, de balles ou d’essence. Parce que nous avons besoin de nourriture. » Caughey affirme que d’autres détenteurs de connaissances inuites ont encouragé des programmes à introduire des aliments traditionnels dans les écoles afin de faire connaître aux jeunes Inuits les viandes que leur famille n’a peut-être pas la capacité de chasser elle-même. « Nous savons qu’il est également très important d’offrir des aliments traditionnels dans des espaces comme les centres de soins de santé et les garderies », dit-elle. Mais cet accès aux aliments traditionnels dépend de l’argent. Caughey affirme que les programmes qui aident les pêcheurs doivent être renforcés et tenir compte des coûts élevés, par exemple, de la possession et du ravitaillement d’un bateau. « Les programmes qui financent [les chasseurs] devraient être considérés comme des initiatives de sécurité alimentaire », dit-elle, « parce qu’il s’agit de soutenir les chasseurs qui peuvent partager leurs connaissances au sein de leur communauté, en particulier avec les jeunes chasseurs. Les programmes qui appuient la mise en commun des connaissances au sein des communautés pour des choses comme la chasse, la préparation et la préservation des aliments sont de réelles initiatives de sécurité alimentaire. » Soulignant que de nombreuses raisons pourraient expliquer pourquoi certains Inuits ne sont pas en mesure de pratiquer la chasse comme ils le souhaitent, Penney insiste sur l’importance d’initiatives de mise en commun des connaissances comme la trousse d’outils Inuksiutit. « Ces types de ressources visent vraiment à préserver ces compétences et ces connaissances pour les générations futures », dit-elle. Le désir de transmettre leurs connaissances est ce qui a poussé Katsak et son mari à participer au projet Inuksiutit. « L’une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous impliquer », souligne-t-elle, « c’est que nous devons être en mesure d’enseigner à la jeune génération par l’entremise des médias, de Facebook et de YouTube. Nous devons pouvoir utiliser cet outil pour enseigner à la jeune génération comment préparer les aliments de la bonne façon. Comment les nettoyer, les préserver de façon sécuritaire et les entreposer. Et nous devons être en mesure d’enseigner comment couper la viande adéquatement. » En particulier, ils sont motivés à enseigner aux jeunes Inuits comment ils peuvent utiliser toutes les parties des aliments traditionnels sans laisser de déchets. « Il est possible de dépecer la viande correctement afin de la conserver », explique Katsak. « Mettre la viande en cache, la faire sécher, tout ce qu’il faut faire pour préparer les aliments. Le programme nous a permis d’enseigner tout ça Il ne faut pas le jeter. Il faut s’en occuper correctement. » « Certains efforts sont faits pour assurer la sécurité alimentaire là-bas, et on devrait enseigner davantage la préparation et l’utilisation de la viande. Parce que les jeunes n’ont pas les connaissances nécessaires. » Continue Reading
Chercheuse dans la sécurité alimentaire : Nunavut est frappé par la pire crise alimentaire quelle ait jamais vue

Leave a Comment