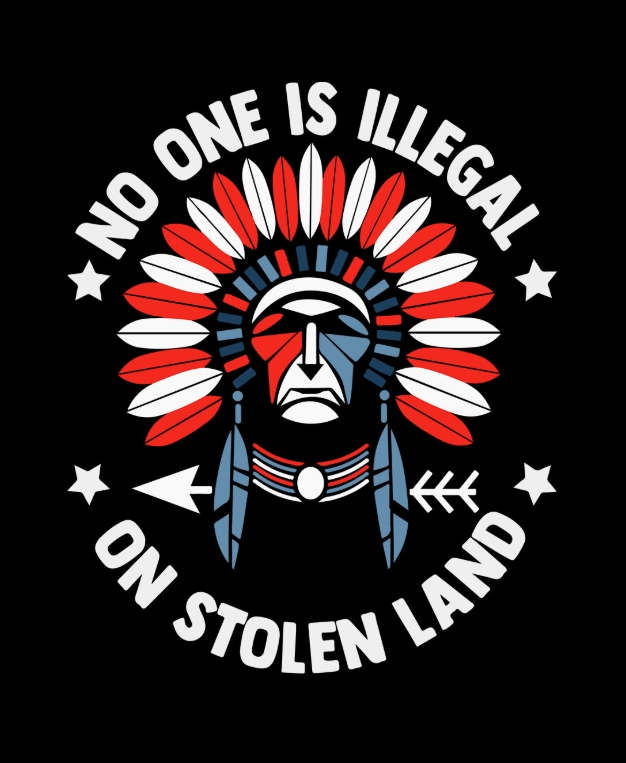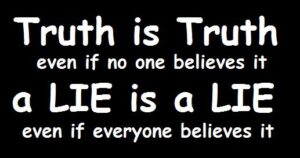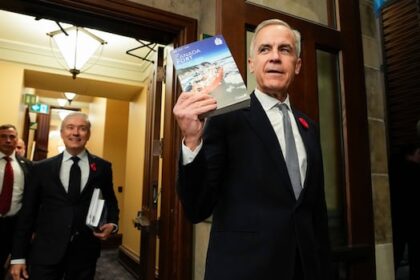Le chef du service de police du territoire mohawk de Kahnawake, au Québec, Dwayne Zacharie, affirme que les services de police autochtones ont de la difficulté à fonctionner sans être désignés comme un service essentiel. « Les communautés des Premières Nations et les communautés inuites méritent un service comparable ou même supérieur à ce qui existe. Les seuls services qui sont en mesure de le faire, ce sont les services autochtones », a déclaré Zacharie à APTN News. « Ce que je voulais dire au comité, c’est que si nous disparaissons, il y aura un manque. Et ensuite, qui comblera cette lacune? » Les Peacekeepers de Kahnawake forment l’un des seuls services de police autogérés en Amérique du Nord composé entièrement d’agents autochtones. Prenant la parole devant le comité des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes, qui évalue les services de police des Premières Nations et des Inuit, Zacharie a déclaré que les lacunes en matière de financement font en sorte qu’il devient difficile pour de nombreuses communautés de soutenir leurs propres services de police. « Il existe 36 services de police autochtones autogérés des Premières Nations, qui assurent le maintien de l’ordre sur environ le tiers de la superficie du pays », a déclaré Zacharie, qui est également l’ancien chef de l’Association des chefs de police des Premières Nations. « Cela représente environ 156 communautés à l’échelle du pays. Et en ce moment, ils éprouvent tous des difficultés. » Dans une entrevue accordée à APTN News, Zacharie a déclaré que certains services de police autochtones ont fermé leurs portes et ont été remplacés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou des organismes provinciaux, et que d’autres pourraient suivre. « Nous n’avons pas les ressources dont nous avons besoin », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas continuer. Nous fermons nos portes. Ensuite, un autre service, quel qu’il soit, vient faire le travail à notre place. » La GRC, la Police provinciale de l’Ontario ou la Sûreté du Québec sont les corps policiers qui remplacent les services de police autochtones, et Zacharie affirme qu’ils coûtent beaucoup plus cher que les services de police locaux. « [Le coût] sera deux, trois, quatre, dix fois plus élevé. Et qui paiera la facture? Embaucheront-ils des gens qui parlent la langue? » Steeve Mathias, chef de la Première Nation de Long Point, située dans l’établissement de Winneway, dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec, a déclaré au comité qu’il se souvient des six années qu’il a passées comme seul policier de la communauté, travaillant « sept heures de façon active et 17 heures en obligation de disponibilité ». À un certain moment, la nation Long Point a signé une entente tripartite avec le gouvernement fédéral et le Québec. Cependant, Mathias a déclaré qu’à son avis, cette entente était présentée comme non négociable, et que lorsque la communauté n’a pas pu obtenir un financement de 100 000 $ supplémentaires pour les services de police, elle n’a pas été renouvelée en 2006. C’était la fin des services de police locaux à Long Point. « Après la fermeture de notre service de police », a-t-il dit au comité, « la SQ a pris la relève et dessert maintenant ma communauté depuis 20 ans. » La SQ employait quatre agents et utilisait deux véhicules 24 h sur 24, ce qui lui coûtait 1,8 million de dollars par année, ce que Mathias estimait comme un montant bien supérieur à ce qu’il en coûtait à la communauté pour son propre service de police. Le chef Steeve Mathias de la Première Nation de Long Point s’adresse au Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes, le 29 octobre. Capture d’écran tirée d’une vidéo sur ParlVu Mathias a déclaré que les gouvernements fédéral et provincial ont nui aux efforts de sa communauté pour rétablir son propre corps policier. Il allègue qu’Ottawa a dit que l’argent n’était pas disponible et que le programme était en cours d’examen, tandis que le Québec a promis de créer une équipe régionale d’intervention rapide qui n’a jamais vu le jour, même si la province a mis sur pied de nouveaux services de police dans les Premières Nations avoisinantes de Kebaowek et de Timiskaming. « Nous sommes ravis pour eux », a-t-il souligné, « parce que nous savons que c’est ce dont ils avaient besoin pour répondre aux besoins de leurs communautés. Cela dit, rien ne se passe à Winneway. » Mathias a déclaré que lorsque la SQ a pris en charge les services de police dans la région de Long Point, elle a commencé à publier des statistiques qui montrent que Winneway fait plus d’appels à la police que les 17 autres municipalités de la région du Témiscamingue. « Lorsque cela est devenu plus largement connu », a-t-il déclaré au comité, « [la SQ] a cessé de publier les données parce qu’elles montraient qu’il y avait un tel besoin à Winneway et qu’elle avait vraiment perdu le contrôle de ce qui se passait ici, dans notre communauté. » Le plus important, c’est la confiance Brendan Hanley, député libéral du Yukon et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l’Arctique, a demandé à Zacharie en quoi les Peacekeepers se distinguent de la SQ, sur le plan opérationnel. Zacharie a déclaré que le plus important, c’est la confiance, et que celle-ci ne pouvait être présente dans une Première Nation que lorsque le service de police était assuré par ses propres membres. « Nous avons des programmes de prévention », a-t-il dit, « et nous constatons que le fait d’aller dans nos écoles, et de rencontrer les jeunes et les membres de la communauté contribue grandement à réduire certains types de statistiques. Nous offrons des programmes de lutte contre la violence familiale. « Nous avons aussi des programmes de lutte contre la toxicomanie et des programmes de lutte contre la récidive en matière d’infractions relatives aux drogues. Nous avons notre propre système judiciaire dans la communauté. Nous avons un programme appelé Skén:nen Aonsón:ton, qui est un mécanisme alternatif de règlement de litiges. Tous ces programmes vont plus loin en nous aidant à faire notre travail sur notre territoire. » Ces programmes sont fondés sur la confiance communautaire envers les Peacekeepers de Kahnawake, qui parlent le kanien’keha, la langue mohawk, et connaissent la culture. Ils connaissent également bien les gens et la région. « Ils connaissent toutes les routes du territoire », Zacharie a déclaré au Comité permanent des affaires autochtones et du Nord. « Dans notre communauté, il n’y a pas de numéro de rue, et il faut connaître tout le monde. On parle de 10 000 personnes. » Zacharie fait valoir que les Peacekeepers répondent à toutes ces exigences, sans faire appel à des gens de l’extérieur qui ne connaissent pas la communauté, sa culture et ses traditions. C’est sans parler de l’ensemble complexe de traumatismes intergénérationnels qui touchent à la plupart des communautés autochtones. En savoir plus : Les 22 corps policiers autochtones du Québec déposent une plainte Nouveau poste de police pour Opitciwan Zacharie a déclaré à APTN qu’il a récemment participé à une réunion de l’Association canadienne des chefs de police au cours de laquelle le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, a annoncé le financement de 1 000 nouveaux agents de la GRC. En revanche, il a précisé que la dernière fois que les services de police des Premières Nations et des Inuits se sont vu offrir du financement pour des augmentations de personnel remonte à 2017 ou 2018, alors qu’on leur avait offert 110 agents dans les 36 services de police autochtones du Canada. « Mais il y avait un petit bémol », dit-il. « En fait, ils nous ont dit que ce ne serait pas réellement 110, parce que la GRC assure également les services de police dans les communautés des Premières Nations partout au pays. Ils ont donc ajouté 55 agents aux effectifs de la GRC, et nous avons dû nous partager les 55 autres. Ensuite, ils nous ont envoyé ces formulaires de demande et nous ont fait entrer en concurrence les uns avec les autres! » Zacharie affirme que, lors du processus de dépôt des formulaires, il est devenu évident que les 36 services de police autochtones avaient besoin d’environ 550 agents supplémentaires. « Ils ne nous en ont offert que le dixième. » Parmi les préoccupations les plus pressantes de chaque service de police autochtone, il y a le fait de ne pas être désigné comme service essentiel. Zacharie affirme que la communauté considère les Peacekeepers comme essentiels, et fait appel à eux chaque fois qu’ils font face à une situation d’urgence, mais que cela ne s’applique pas au gouvernement fédéral. Il a plutôt fait valoir que le gouvernement fédéral ne conçoit que des « programmes », dont la durée est limitée, après quoi le financement prend fin. Mais parfois, l’argent disparaît avant la fin de l’entente. « Donc, même si nous signons une entente pour 10 ans, mais que le gouvernement n’a de l’argent que pour cinq ans, que se passe-t-il? Le gouvernement n’a pas de problème à revenir sur ses promesses. » Zacharie affirme que le Programme fédéral des Premières Nations et des Inuits est déjà « terriblement sous-financé », tout en soulignant qu’une partie de ce financement est également destinée aux corps policiers non autochtones exerçant leurs activités dans les territoires autochtones. « Ils envoient la facture au gouvernement, et ils obtiennent l’argent de notre programme. Par conséquent, tous les fonds du programme ne sont pas consacrés aux services de police des Premières Nations. J’ai assisté à des réunions où certains de ces grands services se plaignaient parce qu’ils n’avaient pas encore reçu d’argent du gouvernement pour assurer tous ces services de police. Et je me suis dit : “Vous ne savez pas la moitié de ce qui se passe. ” « Nous demandons un financement prévisible à l’avenir, comme c’est le cas pour d’autres services. Pensez-vous que les grands corps de police du Canada ne connaissent pas leur budget de l’an prochain? Bien sûr que non. » Zacharie affirme que ses propos et ceux d’autres chefs ont été résumés par la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan. Dans son rapport de 2024 au Parlement, madame Hogan a constaté que le gouvernement fédéral « ne travaillait pas en partenariat avec les communautés autochtones pour offrir un accès équitable à des services de police adaptés à leurs besoins ». Pendant ce temps, elle a constaté que des millions de dollars affectés au programme n’avaient pas été dépensés. « Votre propre organisme de vérification affirme que vous échouez », a déclaré Zacharie. « Vous ne tenez pas vos promesses. » Sur sa page Web, Sécurité publique Canada reconnaît qu’elle fait actuellement face à « des risques juridiques liés au Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit. Les Nations et les organisations représentatives ont entamé diverses procédures judiciaires contre le gouvernement du Canada en soulevant la question du sous-financement des services de police des Premières Nations et des installations policières. » « Bon nombre de ces affaires ne sont pas encore réglées, mais en raison de leur potentiel de précédent financier, politique et juridictionnel, Sécurité publique Canada cherche activement des moyens d’atténuer les réclamations, de régler les problèmes qui ont donné lieu aux litiges et d’éviter les contestations judiciaires à l’avenir. » Continue Reading
Les députés écoutent comment les forces de police autochtones luttent pour éviter de disparaître

Leave a Comment