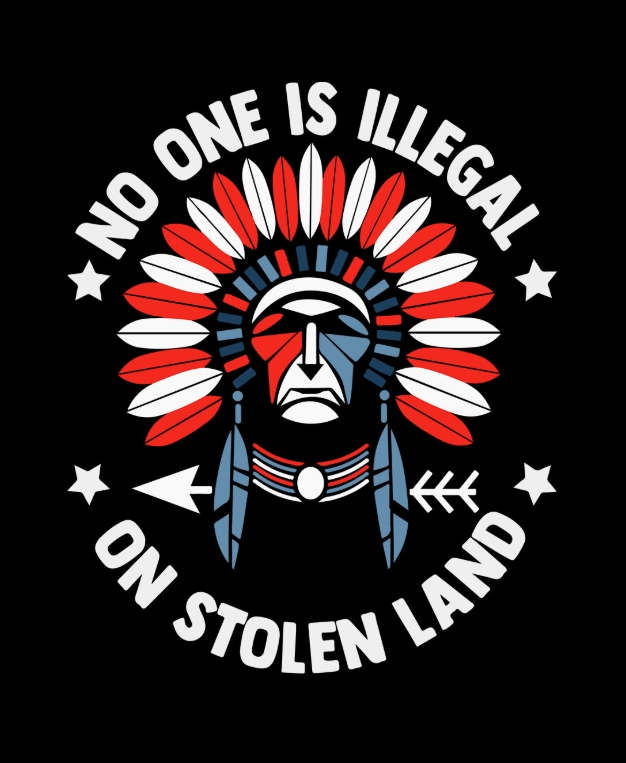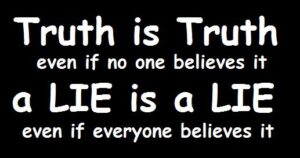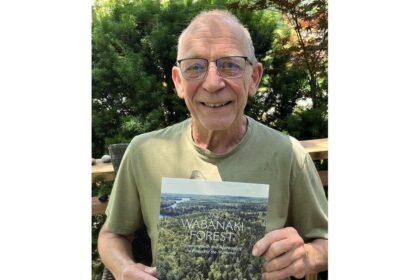Alors que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) tente d’établir une constitution pour la province de Québec, des dirigeants autochtones et des experts juridiques affirment que la loi proposée est vouée à l’échec. Selon l’avocat innu Nadir André, des problèmes apparemment mineurs dans l’ébauche du texte de la constitution pourraient mener à l’annulation de celle-ci devant les tribunaux. André, qui est originaire de Matimekush Lac-John, dans le nord du Québec, affirme que l’article 23 du projet de loi, qui stipule que le territoire du Québec est indivisible et que ses limites ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement de l’Assemblée nationale, ne passera pas le test des tribunaux. André soutient que chacun des 11 peuples autochtones du Québec a son propre territoire ancestral et a les mêmes droits à l’autodétermination en vertu de la loi que les autres peuples du monde. André explique que la Constitution canadienne ne garantit pas l’intégrité territoriale et l’indivisibilité des provinces. « [Le projet] de Constitution québécoise va beaucoup plus loin que ce que prévoit la Constitution canadienne en ce qui concerne les limites d’une province », explique-t-il. Le gouvernement du premier ministre François Legault a déposé son projet de Constitution le 9 octobre dernier. Le document fait suite au Rapport du Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la fédération canadienne, déposé à la fin de 2024, qui exhortait le gouvernement du Québec à établir sa propre constitution pour confirmer son autonomie au sein du Canada. Le rapport suggère qu’une constitution renforcerait le Québec en décrivant les lois, les valeurs et les décisions juridiques distinctes qui ont façonné la province en tant que société. Plusieurs dirigeants autochtones ont rejeté d’emblée la proposition de « loi des lois ». En août, alors que la constitution proposée était encore en cours de rédaction, le grand chef Cody Diabo, du Conseil des Mohawks de Kahnawake, a déclaré avoir rencontré le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, pour lui faire part de son opinion. « Il n’y a pas de nation québécoise », a déclaré Diabo à APTN Nouvelles nationales en août. « Au final [Jolin-Barrette est] canadien. […] Nous avons des ententes avec la Couronne britannique, qui a délégué cette responsabilité au gouvernement fédéral, et [François Legault et la CAQ] ne représentent que le gouvernement provincial. À mon avis, l’idée de créer une constitution est ridicule. » En savoir plus : « Il n’y a pas de nation québécoise » : le grand chef adresse un message sévère au ministre de la Justice du Québec Le bilan de l’APNQL sur les performances du Québec à propos des relations avec les Premières Nations Depuis le dépôt du projet de loi 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, de plus en plus d’Autochtones s’y opposent, en particulier parmi ceux qui ont remarqué que les Premières Nations et les « nations autochtones du Québec » ne sont mentionnées qu’à trois reprises au début du document. L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a demandé au gouvernement Legault de consulter les 42 Premières Nations du Québec. Certains dirigeants des Premières Nations ont attaqué le projet constitutionnel, notamment le grand chef de la nation wendat Pierre Picard, le chef Jean-Charles Piétacho du Conseil innu d’Ekuanitshit et le chef Sipi Flamand du Conseil des Atikamekw de Manawan. « Ce projet de loi nie complètement les droits et la place des peuples autochtones au Québec », a déclaré Flamand à APTN. « Puis, en plus, il est prêt à redéfinir un nouveau régime sans tenir compte de notre existence par rapport à nos droits qui sont protégés par l’article 35 dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982. » Flamand a cité la brève mention des droits autochtones dans le préambule du projet de constitution lui-même, la qualifiant de « presque décorative ». « Les droits des peuples autochtones ne peuvent pas être traités comme une note de bas de page dans un projet de constitution », a déclaré Flamand. « Ils doivent être inscrits et reconnus de manière substantielle quand il découle d’une obligation constitutionnelle déjà existante, puis également des engagements internationaux, par exemple, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. » Au lendemain de la bataille que de nombreux dirigeants autochtones ont livrée tout au long de l’été à la CAQ au sujet du projet de loi de modernisation de la foresterie, qui a été retiré depuis par le gouvernement, Flamand a déclaré qu’à son avis, le gouvernement du Québec tente toujours de gouverner de façon unilatérale, sans la participation et l’engagement des Premières Nations. « Je dirais que c’est carrément du racisme systémique que le gouvernement caquiste a envers les Premières Nations », a-t-il déclaré. « Le Québec agit comme si les Premières Nations n’existaient pas. C’est encore une attitude coloniale qui perpétue l’exclusion. » Mention de « nations », mais pas de « peuples » André a déclaré à APTN que cette tentative de mettre fin aux discussions sur les revendications territoriales des peuples autochtones au sein de la province est liée au refus du projet de constitution de mettre les premiers peuples sur un pied d’égalité avec les Québécois. « Dans le projet de constitution, le gouvernement du Québec se définit comme un peuple et une nation », explique-t-il, « mais qualifie les peuples autochtones de simples nations. Le gouvernement n’utilise pas le terme « peuple », même si l’article 35 de la Constitution canadienne fait référence aux « peuples autochtones ». Ils le font exprès? Pourquoi le Québec ne reconnaît-il pas à tout le moins que les peuples autochtones sont à la fois des peuples et des nations »? André fait remarquer que les peuples autochtones ne sont pas des Québécois, mais le projet de constitution semble suggérer que tous ceux qui vivent sur le territoire du Québec sont des Québécois par définition. Il parle d’une « fausse hypothèse ». « Maintenant, ce territoire n’est pas clairement défini », a déclaré André. « Le Québec dit, très simplement, que le territoire du Québec est le territoire actuel de la province. Et cette question est loin d’être réglée. » Pour André, un autre irritant important est l’argument selon lequel les Québécois francophones ont été « colonisés » par le Canada anglais et doivent se défendre collectivement, tout en refusant de reconnaître la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il fait valoir que le gouvernement Legault « a manqué une occasion en or de faire preuve de bonne foi […] en donnant l’exemple, en reconnaissant qu’il y a d’autres peuples qui vivent [sur le territoire] et que [le Québec] reconnaîtra leurs droits. Quelle bonne façon de mettre en lumière le fait que [les Québécois francophones] ont également besoin d’être reconnus et protégés par des droits collectifs. » André affirme que le Québec a refusé de reconnaître l’existence du titre ancestral pendant une grande partie de son histoire. Cependant, deux décisions importantes rendues en 1973 ont forcé la main de la province. La décision d’Albert Malouf, juge de la Cour supérieure du Québec, qui a accordé une injonction aux Cris et aux Inuits pour mettre fin aux travaux du projet hydroélectrique de la baie James et la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Calder et al. c. Procureur général de la Colombie-Britannique reconnaissent l’existence du titre ancestral. André explique que deux éléments de la décision de la Cour suprême viennent confirmer la validité du titre ancestral. D’abord, les peuples autochtones vivaient en sociétés organisées en tant que nations souveraines avant l’arrivée des Européens. Une image de la Proclamation royale prise aux Archives nationales du Canada. Photo : APTN. Ensuite, la Proclamation royale de 1763 ne permettait pas d’acquérir des terres autochtones sans le consentement du peuple, à moins que le peuple lui-même ne transfère ses titres à la Couronne. André dit que, même si de nombreux dirigeants politiques du Québec se sont opposés à la Proclamation royale dès le début et ont continué de s’y opposer pendant plus de 200 ans, celle-ci n’a jamais été abrogée ni remplacée. Ce n’est qu’en 1973 que l’affaire Calder devant la Cour suprême du Canada est venue confirmer l’existence du titre ancestral. « Selon la loi, si vous n’avez pas renoncé à vos titres, si les peuples autochtones n’ont pas transféré leur titre à la Couronne, ils détiennent toujours ces titres », précise André. « Pour les peuples autochtones, la Proclamation royale est non seulement toujours pertinente, mais elle est aussi primordiale. » Selon André, ces éléments sont de mauvais augure pour le projet de Constitution québécoise, car ils privent le gouvernement du Québec de toute capacité d’ignorer le titre ancestral, qui est toujours en vigueur auprès de tous les peuples autochtones de la province qui n’ont pas signé de traité. Toute tentative de faire valoir le concept d’un territoire fixe et indivisible pourrait être annulée simplement par cette reconnaissance du titre ancestral. André est d’avis que le projet de constitution est un document difficile à défendre devant les tribunaux. Il se demande si l’APNQL, le Conseil mohawk de Kahnawake ou toute autre Première Nation ou organisation autochtone planifie une contestation juridique du projet de constitution. Flamand se pose la même question. « On souhaite que les autres leaderships autochtones puissent prendre position par rapport à ce projet de loi », a-t-il déclaré. « Nous demandons un vrai dialogue de nation en nation, pas un projet imposé d’en haut. Nos droits sont pleinement protégés dans la Constitution canadienne, puis si le Québec va de l’avant avec son propre projet de loi constitutionnel sans impliquer les Premières Nations, les peuples autochtones, c’est un grand manquement qu’il fait dans ses relations avec les Premières Nations. » Dans un courriel adressé à APTN, le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a déclaré : « Le projet n’affecte pas et ne remet en question les droits ancestraux des nations autochtones du Québec ou ceux issus de traités. Au contraire, la Constitution rappelle dans son préambule l’importance qu’occupent les réalités autochtones au Québec. La reconnaissance des 11 nations dans la loi des lois reflète l’engagement du Québec à poursuivre des relations basées sur le respect mutuel et le partenariat de nation à nation. » APTN a demandé une entrevue au cabinet du premier ministre François Legault, mais nous n’avions pas reçu de réponse au moment de mettre sous presse. Nous avons communiqué avec la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, qui est Innue, ce qui fait d’elle la seule personne autochtone siégeant à l’Assemblée nationale du Québec, pour lui demander ce qu’elle pense des critiques autochtones à l’égard du projet de constitution. Ses attachés nous ont demandé de nous adresser au cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, qui nous a transmis la déclaration ci-dessus. Continue Reading
Avocat innu : la Constitution québécoise pourrait être annulée devant les tribunaux

Leave a Comment