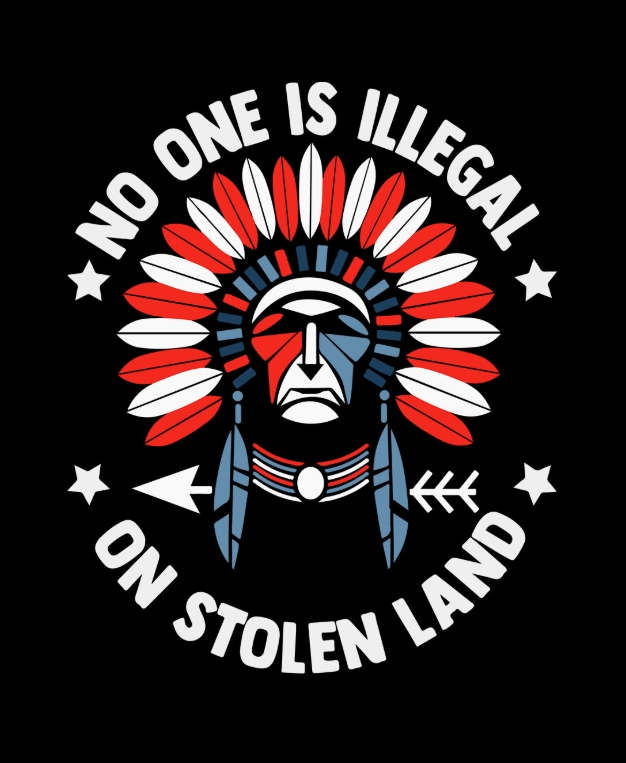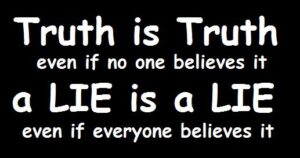Il y a un an, la banque alimentaire de Cambridge Bay, dans la région de Kitikmeot, au Nunavut, desservait environ 250 familles dans cette communauté de près de 2 000 habitants. Mais à ce moment là, les Inuit recevaient des fonds du Programme de bons alimentaires pour les hameaux (PBAH), qui accordait aux familles 500 dollars par mois et par enfant pour l’alimentation, et 250 dollars supplémentaires par enfant de moins de quatre ans pour les couches. En mars 2025, Services aux Autochtones Canada a mis fin à ce programme. Bien qu’il ait fallu du temps pour que les paiements cessent dans toutes les communautés, Leonard Langan, coordinateur de la banque alimentaire du Cambridge Bay Wellness Centre, a indiqué que les derniers fonds sont arrivés dans son hameau en juillet dernier. « Cela a certainement aidé beaucoup de familles qui ont des difficultés financières à nourrir leurs proches », a déclaré Langan à APTN Nouvelles nationales. « Après la fin du programme, nous avions atteint 489 familles, qui dépendaient de la banque alimentaire. Et nous n’avons pas un budget suffisant pour soutenir un tel nombre. « Nous ne pouvons donc pas donner beaucoup de nourriture supplémentaire aux personnes qui viennent à la banque alimentaire. Nous leur donnons juste le minimum nécessaire pour qu’elles puissent s’en sortir. Nous leur offrons tout ce que nous pouvons. » Actuellement, a déclaré Langan, son organisation s’efforce pour coordonner son programme de paniers de Noël. « Nous essayons de distribuer 200 paniers pour la période de Noël aux familles vraiment dans le besoin », a-t-il déclaré, « et c’est difficile de trouver des fonds pour offrir de la nourriture à autant de familles. » Le fait de ne pas pouvoir donner de la nourriture aux membres de la communauté qui viennent à la banque alimentaire pèse sur Langan. « On se sent un peu mal pour les personnes qui en ont besoin », dit-il, « qui viennent et à qui on ne peut donner que quelques articles. On sait que cela ne durera pas longtemps, surtout pour les personnes qui ont trois ou quatre enfants. C’est difficile de donner un petit sac de nourriture à quelqu’un quand on sait que cela ne suffira que pour un repas ou quelque chose comme ça. » À plus de 660 kilomètres au sud-est, à Baker Lake, dans la région de Kivalliq, Mark Oklaga, de la banque alimentaire de la Abluqta Society, explique que son organisation est également en difficulté. « La situation alimentaire est assez grave en ce moment », confie-t-il à APTN. « Depuis la fin du programme [PBAH], les gens ont du mal à se procurer de la nourriture. » Comme pour la banque alimentaire de Cambridge Bay, Oklaga a déclaré que son organisation a traversé des périodes où elle n’avait pas assez de nourriture pour nourrir toutes les personnes qui se présentaient. Heureusement, pour l’instant, la banque alimentaire de l’Abluqta Society est en mesure de répondre aux besoins des nécessitants. Le personnel de la banque alimentaire de l’Abluqta Society à Baker Lake, au Nunavut, prépare des repas pour les membres de la communauté. Photo : Abluqta Society Pourtant, Oklaga se dit alarmé par le nombre croissant de jeunes enfants qui viennent manger des repas chauds. « C’est parfois très triste de les voir arriver », dit-il. « Certains d’entre eux disent qu’ils n’ont pas mangé depuis plusieurs jours. J’essaie de ne pas me laisser envahir par l’émotion. Je suis très triste, mais j’essaie de contenir ma tristesse et de les aider autant que possible. J’essaie de donner les restes à tout le monde. » Sabrina Maniapik est coordinatrice du bien-être communautaire à Pangnirtung, dans la région de Qikiqtaaluk, à 1 400 kilomètres à l’est de Baker Lake. Elle explique que lorsque le financement du PBAH a pris fin, le service de repas chauds du centre d’accueil Sailavik Safe and Sober Drop-In a commencé à être de plus en plus fréquenté chaque semaine. « Nous voyons des familles consulter les réseaux sociaux [pour voir] si quelqu’un a des restes », dit-elle, « ou écouter la radio locale, pour savoir si quelqu’un donne quelque chose, juste pour [avoir de quoi manger] pendant un jour ou deux. C’est triste d’entendre tant d’histoires de gens qui se trouvent dans cette situation. Surtout ce qui touche l’insécurité alimentaire pour les enfants. « Ce n’est pas seulement le cas des enfants, mais aussi des adultes, qui n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins fondamentaux. » Fin septembre, le Qajuqturvik Community Food Centre (QCFC) d’Iqaluit a tenu une conférence de presse pour annoncer que la demande alimentaire, en hausse depuis 2022, dans la seule ville du territoire, devenait ingérable. Au cours d’une journée de la semaine précédente, 8 % de la population d’Iqaluit est venue manger un repas chaud au QCFC. « Nous ressentons cette demande devient écrasante pour nous dans notre salle à manger et dans notre cuisine », a déclaré Joseph Murdoch-Flowers, directeur exécutif du QCFC. Le Dre Sindu Govindapillai, pédiatre à Iqaluit et directeur exécutif de l’Arctic Children and Youth Foundation, a qualifié la situation de « pire crise de sécurité alimentaire que j’ai jamais vue ». Elle a souligné que, selon les données de Statistique Canada pour 2022, 79 % des enfants de moins de 14 ans au Nunavut vivaient dans des situations d’insécurité alimentaire. « Nos patients, nos clients, prennent des mesures désespérées pour nourrir leurs enfants », a-t-elle déclaré. APTN demande au gouvernement fédéral s’il y a une « crise alimentaire » au Nunavut Dans les semaines qui ont suivi la conférence de presse du QCFC, APTN s’est entretenu avec quatre experts, deux Inuit et deux non-Inuit, qui connaissaient bien les communautés de différentes régions du Nunavut. Tous ont décrit le territoire comme étant en situation d’« urgence alimentaire » ou de « crise alimentaire ». APTN a demandé à s’entretenir directement avec un représentant de Services aux Autochtones Canada (SAC) afin de discuter de la décision de mettre fin au PBAH, de comprendre les attentes du SAC suite à la fin du programme et de savoir si des plans d’urgence étaient en place pour répondre aux besoins alimentaires accrus dans les communautés. SAC n’a pas accepté de nous accorder d’entretien par téléphone ou en personne et nous a demandé d’envoyer nos questions par courriel. Lorsque nous l’avons fait, SAC nous a acheminé une réponse où la plupart des questions clés que nous avions soulevées n’ont pas été répondues. C’est-ce que APTN a fait savoir au SAC dans le courriel de suivi, envoyé le 14 octobre dernier et demandant, à nouveau, si : « Les Services aux Autochtones estiment-ils qu’il existe actuellement, en octobre 2025, une situation d’urgence alimentaire au Nunavut ? » Depuis ce courriel de suivi, APTN n’ap plus reçu de réponses de la part du SAC à ce sujet. Lori Idlout (NPD), députée du Nunavut, a déclaré que la décision du gouvernement libéral de mettre fin au programme de bons alimentaires Hamlet « semblait être purement politique ». Photo : APTN Nouvelles nationales La fin du programme de bons alimentaires et l’avenir des programmes similaires Lori Idlout, députée néo-démocrate originaire d’Igloolik, a été élue pour représenter le Nunavut à la Chambre des communes en 2021. Elle a conservé son siège lors des élections fédérales du printemps 2025. Avocate engagée dans la défense de la santé et de la culture inuit, elle a déclaré que la décision du gouvernement libéral de mettre fin au programme de bons alimentaires pour les hameaux « semblait purement politique ». « Lorsque le programme était en vigueur », a-t-elle déclaré à APTN, « les gens me disaient que leur bien-être s’était considérablement amélioré pour différentes raisons. Ils disposaient d’une source de financement régulière et fiable qui leur permettait d’acheter suffisamment de provisions pour leurs enfants, et, grâce à cela, ils pouvaient payer d’autres factures et leur santé mentale s’était améliorée, disaient-ils. « Leur sentiment de bien-être s’était vraiment amélioré pendant la durée du programme. » Elle a déclaré que, lorsque le PBAH a pris fin, des centaines de familles se sont interrogées sur les raisons de son arrêt si soudain. Le PBAH faisait partie de l’Initiative : les enfants inuits d’abord (IEA), que le gouvernement libéral a voté au printemps dernier de prolonger d’un an, jusqu’au 31 mars 2026. Au cours de l’été, la ministre des Services aux Autochtones, Mandy Gull-Masty, a déclaré à CBC News que son bureau était en train de repenser l’IEA et qu’ « il doit être financièrement viable. Il doit disposer d’un financement concret… auquel on peut accéder de manière régulière. » Au début du mois, Gull-Masty a déclaré à Nunatisaq News que son ministère travaillait avec la communauté pour revoir le programme. Elle a souligné qu’elle espérait trouver un moyen de maintenir et de protéger l’IEA et de garantir des solutions, qui lui permettraient de fonctionner à long terme. Idlout est revenue sure le fait que les familles inuit avaient lancé une campagne de lettres qui, selon elle, avait contribué à prolonger le programme jusqu’en 2026. « Même avec cette prolongation d’un an », a-t-elle déclaré, « d’énormes restrictions ont été imposées, et j’entends encore des familles dire qu’elles ont besoin de ce programme. » « Une crise après l’autre » Idlout a déclaré à APTN qu’elle s’est renseignée auprès de différents ministres afin de comprendre les raisons qui ont motivé la décision de mettre fin au PBAH. Elle a également discuté de la question avec le président de Nunavut Tunngavik Incorporated, Jeremy Tunraluk. « Le ministre lui a dit que les gens abusaient du programme », se souvient-elle. « Pour moi, cela ne semblait pas être une réponse acceptable, étant donné le peu d’opportunités de développement économique qui s’offrent aux Nunavummiut. » Idlout a souligné que la crise actuelle n’est qu’une parmi tant d’autres que les Inuit endurent depuis des décennies. « Nous avons vécu une crise après l’autre », dit-elle, « qu’il s’agisse de la crise du coût de la vie, de la crise du logement ou du manque d’opportunités pour être économiquement indépendant. Il y a tellement de problèmes au Nunavut, et peu importe à quel point on en parle, les réponses ne sont jamais suffisantes. » En savoir plus : Chercheuse dans la sécurité alimentaire : Nunavut est frappé par la « pire crise alimentaire » qu’elle ait jamais vue Idlout cite la crise alimentaire comme le plus grand défi auquel sont confrontés les Inuit, en particulier en raison de son impact direct sur les enfants. « Si les enfants ne peuvent pas aller à l’école le ventre plein, ils n’apprendront pas. S’ils ont plus de mal à apprendre, il leur sera plus difficile d’obtenir leur diplôme de fin d’études secondaires », a-t-elle déclaré. Compte tenu de l’histoire des crises liées au manque constant de financement, Idlout a déclaré qu’elle avait du mal à comprendre les raisons qui ont motivé la fin d’un programme destiné à nourrir les enfants. « Je ne pense pas que prétendre que les gens abusaient du programme soit une réponse suffisante », a-t-elle déclaré. La faim est tellement répandue au Nunavut que Sabrina Maniapik, coordinatrice du bien-être communautaire à Pangnirtung, a dit avoir elle-même eu du mal à nourrir sa famille pendant les années où elle ne travaillait pas et dépendait de l’aide sociale pour élever ses jeunes enfants. « Il y avait des jours où, en tant que parent, je ne mangeais pas pendant au moins un jour ou deux juste pour nourrir ma famille, mes petits, pour qu’ils aient quelque chose dans le ventre », a déclaré Maniapik à l’APTN. Faire face à un héritage douloureux Idlout évoque des moments plus sombres de la colonisation des lnuit par le Canada, notamment le massacre de milliers de chiens de traîneau par la GRC entre 1950 et 1970, et la réinstallation forcée des lnuit de la région du Nunavik, au Québec, vers les points les plus élevés de l’Arctique, où ils ont servi de pions dans la revendication territoriale de souveraineté du Canada dans le nord. Les Inuit déplacés vers des communautés de l’Extrême-Arctique comme Grise Fiord étaient qualifiés de « mâts de drapeaux humains » et, bien qu’on leur ait promis l’abondance, ils n’ont trouvé que très peu de ressources à leur arrivée. Le gouvernement fédéral, d’abord sous Stephen Harper, puis sous Justin Trudeau, a depuis présenté ses excuses pour la réinstallation forcée et l’abattage des chiens de traîneau. Pourtant, malgré ces excuses officielles, plus d’un demi-siècle après les injustices en question, Idlout a déclaré que ces agressions coloniales contre les Inuit, leurs communautés et leur mode de vie sont encore présentes dans les mémoires de nombreux Nunavummiut confrontés à une pénurie de nourriture abordable. « Il y a toutes ces promesses non tenues », a-t-elle déclaré, « [et] rien ne justifie la suppression d’un programme qui aidait à nourrir les familles et contribuait, dans une certaine mesure à réduire la pauvreté ». Les mêmes préoccupations concernant la souveraineté de l’Arctique qui ont poussé le premier ministre Louis St Laurent, dans les années 1950, à déplacer de force les Inuit vers le Haut-Arctique, sont à nouveau d’actualité. La semaine dernière, le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, a déclaré devant le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense et des anciens combattants que, si l’on souhaite préserver la souveraineté de l’Arctique, il faudra investir massivement dans les communautés et les infrastructures Inuit. Il a fait remarquer que les familles et les chasseurs inuit parcourent constamment le territoire et signalent tout événement inhabituel à leurs communautés et aux Rangers canadiens, ce qui signifie que la santé et la sécurité des Inuit vivant de manière traditionnelle sont étroitement liées aux préoccupations concernant la souveraineté canadienne dans la région. « Nous insistons sur la nécessité pour le Canada d’investir davantage dans la santé et le bien-être de notre peuple », a déclaré Obed au comité, « afin de conserver et de soutenir les Inuit en tant que ressource future et, la plus importante de la région. Et nous soulignons la nécessité pour le Canada d’adopter une vision plus large pour intégrer le Nunangat au reste du pays. » Idlout a souligné sa crainte que le gouvernement fédéral actuel, dirigé par Mark Carney, ne comprenne pas la logique de cette démarche, car elle estime que le premier ministre se concentre davantage sur la sécurité de l’Arctique que sur la souveraineté de l’Arctique. « Les Inuit et les habitants du Nord veulent s’impliquer dans la sécurité de l’Arctique », a-t-elle déclaré, « mais ils se heurtent à trop d’obstacles pour pouvoir le faire. Les Inuit et les habitants du Nord veulent être défendus en tant que partie intégrante du Canada, mais ils ne veulent pas seulement que l’armée vienne les défendre. Ils veulent être directement impliqués. « Il faut investir davantage dans leur région afin qu’ils n’aient pas à vivre dans des logements surpeuplés, qu’ils n’aient pas à envoyer leurs enfants dans des écoles surpeuplées ou qu’ils n’aient pas à quitter leur communauté pour bénéficier de soins médicaux de base. « On dépense beaucoup plus pour la sécurité de l’Arctique que pour la souveraineté de l’Arctique », a-t-elle ajouté, « et nous devons rééquilibrer cela. » Plus de financement et des objectifs de financement La réponse évidente à la situation actuelle, que les experts qualifient d’urgence alimentaire, est d’augmenter le financement destiné à l’alimentation. C’est précisément ce que faisait le Programme de bons alimentaires pour les hameaux lorsqu’il était en vigueur. Maniapik a déclaré que la faim n’était pas traitée de manière adéquate par les gouvernements qui ont le pouvoir d’améliorer la situation des Inuit au Nunavut. « Nous avons besoin de plus de ressources, de fonds disponibles pour lutter contre l’insécurité alimentaire », a-t-elle déclaré. « Nous mangeons des viandes traditionnelles. Les hommes vont chasser, les femmes vont chasser, et tout ce qu’ils attrapent est partagé avec la communauté. Mais dans d’autres situations, on ne peut pas se permettre d’acheter du matériel de chasse parce que c’est trop cher. » Panorama partiel de Pangnirtung, au Nunavut, en été. Photo : Page Facebook de la municipalité de Pangnirtung. À la banque alimentaire du centre de bien-être de Cambridge Bay, Langan a déclaré que son organisation a pu poursuivre ses activités grâce aux efforts locaux de collecte de fonds. « Nous avons des gens qui organisent des collectes de fonds », dit-il. « Nous avons des gens qui contactent différentes organisations pour voir si elles peuvent faire des dons de nourriture ou d’argent pour soutenir les programmes de paniers de Noël. Nous acceptons toujours les dons. » Mais comme la plupart des gens, Langan préférerait voir une solution permanente sur laquelle la communauté pourrait compter. « Nous espérons que le gouvernement prendra les devants et lancera un autre programme, comme celui qu’il avait mis en place avec le [PBAH], afin que nous puissions aider davantage de familles locales », a-t-il déclaré. Oklaga, de la banque alimentaire de l’Abluqta Society à Baker Lake, a convenu que le besoin principal était d’obtenir davantage de financement. « De plus », a-t-il ajouté, « nous avons besoin de plus d’emplois ici ». Le manque d’emplois pour les habitants est également une préoccupation importante pour Idlout, qui a fait remarquer qu’en l’absence d’emplois, il existe également peu de programmes qui soutiennent les Inuit en tant que chasseurs et couturières accomplis. « Notre culture possède de grandes forces, mais nous sommes confrontés à des obstacles au développement économique », a-t-elle déclaré, « car les structures nous obligent à être au chômage et à dépendre excessivement des programmes. » « Les Inuit sont toujours d’excellents chasseurs. Les Inuit sont toujours très doués pour travailler les peaux de phoque et de caribou. Ils ont de grandes forces qui leur permettent de prendre soin de toute la famille. Voyons des programmes qui [créent] des opportunités pour les Inuit de gagner leur propre revenu en s’appuyant sur leurs forces. » Idlout a déclaré qu’elle aimerait voir des programmes qui basent leurs décisions concernant les Inuit sur les compétences et les traditions dans lesquelles ils excellent depuis des millénaires. Arviat : un exemple d’utilisation efficace des fonds À Arviat, dans la région de Kivalliq, à près de 400 kilomètres au sud de Baker Lake, la société Aqqiumavvik tente justement de mettre en œuvre cette approche. Kukik Baker, directrice générale du programme, explique qu’Aqqiumavvik n’est pas une banque alimentaire, mais une société de bien-être axée sur les besoins de la communauté. Selon Baker, Arviat, a le taux de natalité par habitant le plus élevé au Canada, et 60 % de la population a moins de 16 ans. Par conséquent, l’une des offres les plus importantes de la société Aqqiumavvik est le programme Jeunes chasseurs, qui enseigne aux jeunes de moins de 25 ans comment chasser de manière durable. Les membres du programme Jeunes chasseurs de la société de bien-être Aqqiumavvik d’Arviat entourent un aîné. Photo : site web de la société de bien-être Aqqiumavvik. « Ensuite [leur récolte] est partagée dans notre cuisine communautaire », explique-t-elle, « où les adultes peuvent venir apprendre à cuisiner des aliments sains, tant traditionnels qu’occidentaux, et découvrir les aliments de base à avoir dans son garde-manger, apprendre à gérer son budget, et des choses comme ça. » La société Aqqiumavvik répond spécifiquement aux souhaits de la communauté, et Baker précise que les habitants d’Arviat ont demandé d’acquérir des compétences plutôt que de recevoir de la nourriture. « Nous avons décidé de suivre cette voie », dit-elle, « et d’enseigner aux gens comment préparer des recettes saines, comment [gérer] le peu d’argent dont ils disposent pour garder des aliments de base à la maison, de sorte que, même s’il ne reste qu’une semaine avant l’arrivée d’un nouveau revenu, nous puissions quand même essayer de préparer un repas avec le peu que nous avons. » En raison de la faible profondeur des eaux où se trouve la communauté, Arviat manque de narvals et de morses, mais Baker a expliqué que les terres de la communauté sont riches en bélugas, caribous, poissons, ours et oies. L’emplacement d’Arviat est un avantage. « Nos terres sont très accessibles en VTT et en motoneige », a-t-elle déclaré, « vous n’avez donc pas nécessairement besoin d’un bateau, et les bateaux sont très chers. C’est l’une des raisons pour lesquelles notre communauté est chanceuse : nous pouvons nous éloigner davantage. » Selon Baker, un dernier avantage pour la communauté est l’interdiction de l’alcool. Même si Baker a ri en disant qu’Arviat est plus une communauté « humide » qu’une communauté « sèche », elle a fait valoir le point cela faisait tout de même une différence. « Ma tante vivait à Rankin [Inlet] et à Coral [Harbour]. Elle m’a dit : « Tu remarqueras la différence. Presque toutes les maisons ici ont un VTT ou une motoneige. » Et elle a ajouté : « C’est parce que nous n’avons pas d’alcool. » Si nous avions de l’alcool, tout le monde dépenserait son argent en boisson plutôt qu’en équipement pour aller chasser. » Il est important de noter, selon Baker, qu’Arviat maintient de solides traditions de partage communautaire, et que des annonces sont régulièrement diffusées sur Facebook et à la radio concernant la distribution de nourriture locale. « Culturellement, lorsque les gens attrapent leur premier caribou ou leur première baleine, ils ne sont pas autorisés à les manger, mais doivent les distribuer », explique-t-elle, « et c’est donc très courant. En distribuant la viande, on bénit le chasseur en lui garantissant de nombreuses autres chasses fructueuses. » Transmettre cette tradition aux jeunes est l’un des fondements du programme Jeunes chasseurs. Pour la première prise, les parents du chasseur décident de la manière de distribuer la viande selon les coutumes familiales. « Ensuite, pour chaque prise suivante », explique-t-elle, « une partie est livrée aux aînés, à la cuisine communautaire ou à d’autres personnes de la communauté. Beaucoup de chasseurs font la même chose, ils partagent leur prise avec la communauté et veillent à ceux qui pourraient en avoir de besoin. « Il y a aussi des gens qui passent à la radio pour dire : « Si quelqu’un a un peu de viande de caribou ou de muktuk en trop, pensez à moi », et quelqu’un leur apporte alors de la viande. Tout le monde partage. » C’est le type d’infrastructure qu’Idlout aimerait beaucoup voir être mis en place : un financement pour soutenir la chasse traditionnelle et une culture traditionnelle de préparation et de partage des aliments. Elle a fait référence à un rapport de l’Association inuit Kivalliq sur l’utilisation de subventions pour rendre le transport plus accessible aux chasseurs, en réduisant les coûts prohibitifs liés aux armes à feu, aux balles, à l’essence, aux motoneiges, aux VTT et aux bateaux. « Ce genre de choses aidera », a déclaré Idlout. « Non seulement ils peuvent se permettre d’acheter du matériel pour aller chasser, mais lorsqu’ils partent à la chasse, ils partagent leur nourriture avec la communauté. Je pense que cela ferait une énorme différence si les décisions étaient prises en fonction des atouts des Inuit. » Idlout a déclaré qu’elle avait des conversations plus fréquentes avec le ministre des Affaires du Nord et de l’Arctique, ainsi qu’avec les ministres des Services aux Autochtones du Canada et des Relations entre la Couronne et les Autochtones et des Affaires du Nord du Canada. Elle a reconnu qu’elles avaient tous tenté de la rassurer en lui affirmant qu’ils travaillaient sur l’initiative Les enfants inuits d’abord. Cependant, elle leur a répondu que les discussions ne suffisaient pas. « Ils me font part de la confiance qu’ils accordent à leur premier ministre, et je leur ai dit qu’ils devaient travailler avec moi pour que je puisse avoir la même confiance qu’eux, car pour l’instant, ce n’est pas le cas. » Continue Reading
Les gens ont du mal à se procurer de la nourriture : la crise alimentaire se poursuit au Nunavut

Leave a Comment