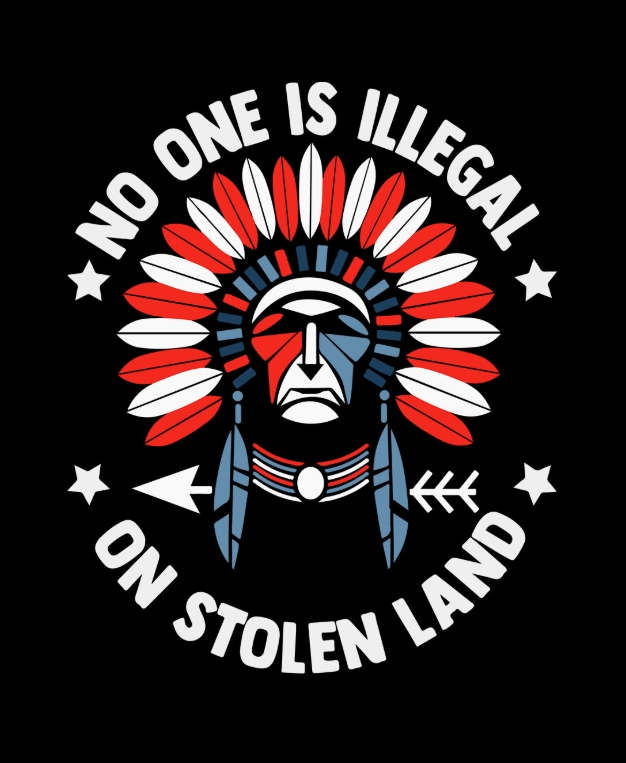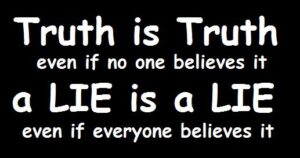La Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif au nom des enfants des Premières Nations, métis et Inuits qui ont subi des abus de la part des services de protection de la jeunesse du Québec depuis 1950. Le recours collectif vise le gouvernement du Québec, son fournisseur de soins de santé, Santé Québec, et 16 centres universitaires et intégrés de services de santé et de services sociaux (les CIUSSS et les CISSS). Le recours vise également le Conseil régional de santé et de services sociaux du Nunavik, ainsi que le Conseil cri de santé et de services sociaux de la Baie James. Selon un communiqué de presse ordonné par le tribunal, toute personne autochtone placée dans un centre de protection de la jeunesse après le 1er octobre 1950 et ayant subi des abus sexuels ou des violences avec ou sans utilisation de dispositifs mécaniques (notamment des camisoles de force, des chaînes et des menottes) ou de substances chimiques (notamment des médicaments) est considérée comme membre du recours collectif. En outre, le groupe comprend toutes les personnes qui ont été placées en l’isolement, enfermées dans une pièce, une cellule ou un espace commun, qui ont subi des commentaires ou des traitements discriminatoires ou désobligeants liés à leur identité autochtone, qui ont été soumises à des traitements médicaux ou dentaires inutiles ou qui se sont vu refuser l’accès à l’éducation. Le recours vise spécifiquement les écoles et centres de protection de la jeunesse, les centres d’accueil et les centres de transition et de réadaptation, ainsi que trois foyers de groupe à Inukjuak, Puvirnituq et Kuujjuaq (Saturvik) dans la région du Nunavik. Le recours ne s’étend pas aux centres hospitaliers, aux autres foyers de groupe et aux familles d’accueil. Le plaignant principal dans le recours collectif est Harry Dandy, de la Première Nation Kebaowek, dans l’ouest du Québec. Selon la demande d’autorisation d’intenter un recours collectif de 2023, Dandy a été envoyé à l’école indienne de jour n° 19 de Temiskaming (EJT) à la fin des années 1950, à l’âge de six ans, où il affirme avoir été régulièrement battu et victime d’autres violences physiques de la part d’enseignants et de prêtres, qui le traitaient de « sauvage » et d’« Indien minable ». Selon la demande, lorsque Dandy tentait de fuir les autorités abusives, il était fréquemment cité pour absentéisme et délits mineurs. À l’âge de 13 ans, un policier a donné à ses parents le choix de le renvoyer à l’EJT ou à la Shawbridge Boys’ Farm and Training School, un centre de détention pour mineurs situé à Prévost, près de Montréal. Selon la requête, pendant les trois années qu’il a passées à Shawbridge, Dandy a subi des abus pires qu’à l’EJT, tant de la part du personnel que de la part des enfants plus âgés, que l’on «chargeait» de «discipliner» violemment les plus jeunes. Selon la requête, ces garçons plus âgés ont agressé sexuellement des élèves plus jeunes avec la complicité du personnel, qui n’est pas intervenu. Comme Dandy se défendait contre le personnel, il était fréquemment placé en isolement et sous surveillance constante. Il a également subi divers traitements dentaires alors qu’il n’avait apparemment pas besoin de tels soins. Selon les dossiers judiciaires, pendant toutes ses années à Shawbridge, Dandy n’a pas été autorisé à contacter ses parents. Ni l’EJT ni Shawbridge, selon la requête, n’ont appris à Dandy à lire. Il affirme n’avoir reçu « aucune éducation » dans cet établissement, mais avoir été profondément marqué émotionnellement et avoir ensuite souffert de retours en arrière liés à ses nombreuses expériences d’abus. En savoir plus : Les services d’enfance au Québec font face à une vidéo virale et des allégations de discrimination Les relations ne s’améliorent pas entre le foyer pour femmes autochtones de Montréal et Batshaw Ces dernières années, Shawbridge a été rebaptisé Centres De Jeunesse Shawbridge et placé sous la bannière de l’organisation de soins financée par le gouvernement Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw. En 2022, près de 60 ans après que Dandy ait déclaré y avoir subi des abus, il a été rapporté qu’un adolescent Inuk de l’établissement, souffrant de graves blessures, s’était vu refuser des soins médicaux et avait été placé en isolement. Lorsqu’il a finalement été transporté à l’hôpital le lendemain pour une opération d’urgence, il a été menotté. Na’kuset défend depuis longtemps les enfants autochtones pris en charge par le système de protection de la jeunesse. En tant que directrice de la Foyer pour femmes autochtones de Montréal, elle a supervisé en 2013 un accord de collaboration entre son refuge et Batshaw visant à améliorer les expériences des enfants autochtones pris en charge par l’organisation. En 2021, Na’kuset a déclaré que l’accord de collaboration avait pris fin après l’absorption de Batshaw par l’agence provinciale de santé, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS). Cette agence est l’un des 16 centres universitaires et intégrés de santé et de services sociaux cités dans le recours collectif. Na’kuset a déclaré à APTN Nouvelles nationales qu’elle estime que les conditions dans les centres de protection de la jeunesse constituent un terrain fertile pour les abus. « Prévost [Shawbridge] est conçu comme une prison, et les enfants sont traités comme des prisonniers », a déclaré Na’kuset. « [Ils] traitent les gens comme des « moins que ». [Ils] ont des règles très strictes, mais il n’y a aucune formation. Il n’y a aucune sensibilité. » Comme dans le cas des pensionnats, les politiques officielles des centres eux-mêmes font l’objet d’un examen minutieux. Le procès porte également sur des cas d’abus sexuels, physiques, médicaux et psychologiques qui allaient bien au-delà des mesures disciplinaires officiellement prescrites au personnel à l’égard des élèves. Tous les élèves qui ont subi les abus décrits dans le recours collectif après octobre 1950 sont considérés comme membres du groupe pouvant prétendre à des dommages-intérêts en cas de victoire devant les tribunaux. Ceux qui ont subi des abus, mais ne souhaitent pas être pris en compte dans le recours ou recevoir des dommages-intérêts ont jusqu’au 15 décembre 2025 à 4 h 30 pour se Continue Reading
Recours collectif autorisé pour les abus subis par les autochtones dans le système de protection de la jeunesse du Québec

Leave a Comment